++L’Afrique en temps de pandémie. Vivre et écrire à l’ère du Covid-19
Epidémythes Africaines.
Doutons-nous quand-même, en dépit du bon sens
En 2016, lorsque les Editions Oudjat furent portées aux fonts baptismaux, grande était la conviction de ses concepteurs de les voir contribuer au changement de mentalité dans les milieux universitaires africains. Cet état d’esprit avait pour levier la création d’une plateforme numérique d’édition scientifique et universitaire mise au point avec le concours de l’Agence universitaire de la Francophonie, précisément, du Campus numérique francophone de Libreville. Ainsi prirent forme Les Editions Oudjat en Ligne (OeL), dont la signature est : « … Penser l’Afrique, … la penser ensemble ».
Notre but était de fonder une collégialité et une collaboration scientifiques autour des paradigmes de recherche touchant prioritairement le continent dit « noir ». D’une certaine manière, les créateurs des Editions Oudjat en Ligne avaient saisi ce qui se passait, en l’occurrence le rapport que les sciences humaines et sociales entretiennent avec les terrains africains depuis leurs introductions dans le continent. Les initiateurs de ce qui n’était qu’un projet y percevaient comme une anomalie, un dysfonctionnement emprunté à l’intelligence des ouvrages destinés à expliquer l’Afrique, un continent sans culture ni tradition scientifique d’après le Selaf ; ce dysfonctionnement s’étendant désormais à une appropriation devenue ordinaire dans les écrits scientifiques des Africains eux-mêmes. Cette perception n’était ni nouvelle, ni originale. Elle est à l’origine de toute la pensée linguistique (lexicographique) d’un M.T. Zezeze Kalonji qui en avait fait le préalable à l’écriture de son livre : La lexicographie bilingue en Afrique francophone. L’exemple du français- cilubà [1]. Seulement, elle apparut aux concepteurs des OeL avec une telle « nudité » qu’ils s’en approprièrent pour en faire un objet de questionnement d’intérêt général.
Cette démarche est celle qui avait déterminé l’esprit du Sénégalais Cheikh Anta Diop, dont les travaux recentrèrent l’intérêt des recherches menées en Afrique sur des problématiques propres. Notamment, à travers le développement d’une pensée critique en confrontations directes avec les concepts, les méthodes et les objets transmis aux Africains par la situation coloniale. La question de « l’antériorité des civilisations nègres » mettait en effet à l’épreuve de nombreux acquis, de nombreux discours, au point que Diop en vint à repenser l’égyptologie d’alors autour d’une systémique combinant linguistique historique et comparée, anthropologie, histoire, physique, etc., pour donner corps à ce que tous les égyptologues contemporains les plus sérieux admettent comme une lapalissade [2].
Mais c’est avec V.Y. Mudimbe qu’apparaît une critique fondée de la métaphysique des sciences humaines et sociales et de la pertinence de leurs usages sur les terrains « noirs ». Cette critique tient à deux inflexions majeures, d’origines philosophique et anthropologique. D’une part, le mimétisme des études africaines déployées par ceux qui avaient pour fonction de produire la science et de dire, à travers leurs écrits, le sens concret de la « pensée sauvage » et de sa métaphysique. Pour Mudimbe, cette critique est moins sévère, car elle résulte de la faiblesse ontologique des sciences humaines et sociales, lesquelles présentent des « limites critiques » face aux expressions de la vie en Afrique. D’autre part, la praxis imaginaire, sociologique, anthropologique et politique africaine, pensait-il dans L’odeur du père [3], contient en quelque sorte les présupposés initiaux qui avaient conduit à la production de leurs épistémologies dominées, en occident, par une volonté de puissance traduite par la maîtrise de la nature (A. Berque, Œcoumène), et/ou de la Nature (d’Isaac Newton à Max Planck, et Max Planck à Stephen Hawking).
Mais le contexte européen, favorable à l’érection des méthodes scientifiques dites critiques, avait laissé prospérer dans la conscience collective l’idée de sciences neutres, froides et distantes avec leurs objets. Contaminées par cette vague, les sciences humaines et sociales devaient elles aussi se garantir une certaine objectivité scientifique. Les pratiques réflexives ainsi renouvelées devaient aider les communautés savantes à prendre congé des logiques empiristes de la critique du vivant en cours dans les universités occidentales héritières de la philologie et des approches historicistes (R. Barthes, Critique et vérité). Ainsi, dans les années soixante jusqu’aux années quatre-vingt-dix, on eut droit à une diversité d’ouvrages portant sur les questions de procédures scientifiques, que d’aucuns avaient désigné par le vocable de structuralisme, voire d’épistémologie.
Jusque dans un passé encore récent, on avait cru à l’idée d’une épistémologie générale froide, non partisane, et même non paternaliste. Si l’idée peut être défendue et soutenue, elle a néanmoins montré ses limites. Le droit de douter et de critiquer la présence des sciences sur les terrains africains repose sur les usages qu’en ont faits nombre d’acteurs. L’euphorie et la croyance, presque naïves au pouvoir épistémologisant des discours scientifiques appliqués aux terrains africains eurent en effet de nombreux dégâts, fruits à la fois de l’ethnologie et des ethnosciences, et des téléologies phonocentristes [4]. Le monde contemporain, et l’Afrique en particulier, paie le prix fort de cette culture relativiste : sur le plan critique, elle a développé des réflexes de subsidiarité au point que les personnels scientifiques africains, consciemment ou non, ont développé de réflexes de subordination épistémologique vis-à-vis de l’Occident, développant ainsi chez eux des sciences asymétriques. Sur le plan structurel, notre continent a renoncé à se doter d’infrastructures scientifiques compétitives, en matière d’université, de centre de recherche et de développement scientifique. La conséquence de tout cela est qu’il ne participe pour rien à la production des savoirs au niveau mondial [5].
La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si la critique de Mudimbe reste toujours pertinente. Depuis son émergence, qu’ont fait les Etats africains, en général, et les universités du continent en particulier ? Que continuent-ils de faire de la science des autres pour se comprendre eux-mêmes ou aider le monde à comprendre l’Afrique à partir de ses propres discours critiques ? A l’échelle gabonaise, si l’on s’en tient à Organisation et système universitaire au Gabon. Sociologie des processus et systèmes institutionnels au Gabon [6] : « rien ». A l’échelle planétaire, la réponse de Bonaventure Mvé-Ondo est on ne peut plus claire. Le continent a développé une fracture scientifique qu’elle nourrit et dont elle se nourrit, à travers son incapacité à répondre à sa propre demande de développement en se fondant sur sa « raison » [7]. L’auteur d’Afrique. La fracture scientifique renchérit : « l’implantation de la science en Afrique vient accompagner l’effort d’économies extraverties fondées sur l’exportation des ressources naturelles. D’où une science restée ici au service exclusif des intérêts étrangers, confirmant du même coup la coexistence de deux modes : le mode de la tradition et celui de la modernité. Avec cette coexistence commence la marginalisation scientifique de l’Afrique » [8].
Cette « fracture », on la doit à certain rapport de domination qu’exerce toujours la science des librairies et bibliothèques occidentales, appuyées par une idéologie de la puissance soutenue par un discours masse médiatique, bureaucratique et diplomatique de divers ordres. Ceci a pour conséquence psychologique l’inhibition des initiatives individuelles et/ou collectives, la croyance aux discours savants en provenance du nord et la négligence des écrits scientifiques du sud, ou leur endiguement par un soft power très persuasif : bourses de coopération, commandes de travaux spécifiques, prescriptions des centres d’intérêts d’études et de recherche qu’accompagnent des soutiens à la mobilité des chercheurs africains multiformes, etc. Comme l’explique Bonaventure Mvé-Ondo, tout cela se faisant au profit exclusif des agences et laboratoires des Etats occidentaux qui en fournissent les moyens financiers, et au détriment de l’Afrique qui, à l’occasion, perd une grande part de ses élites universitaires du coup captés par le système international de recherche.
Pour ainsi dire, la dépendance des savoirs et pratiques scientifiques dont l’Afrique se nourrit et qui hypertrophie la fracture scientifique entre elle et le reste du monde, travaille implicitement ou explicitement à appauvrir l’émergence d’une pensée autonome, repliée sur elle-même et ses objets de façon symétrique, au profit exclusif du développement du continent. D’elle dépend la « décolonisation des sciences humaines » [9] analysée par Joseph Tonda, ou la « nécessité d’une décolonisation conceptuelle », telle que le défend Kwasi Wiredu [10]. L’épidémythe scientifique africaine tient à cela, en la croyance d’une science universelle reconnaissable à des concepts et à des méthodes partout ailleurs opérationnels, et qui ignore la géographie des savoirs, la colonialité épistémologique et ce que celles-ci impliquent pour l’épistémologie classique [11]. Cette croyance, comme celles générées par la pandémie coronarienne qui frappe la planète depuis mars 2020, rappelle nécessairement d’autres mythes, en l’occurrence ceux de l’Occident civilisé sur l’« Afrique sauvage » [12], et ceux que l’Afrique elle-même produit de manière irréflexive [13] quand elle entreprend de s’interroger à partir des sciences humaines et sociales. Cette asymétrie épistémologique et métaphysique, on la trouve partout dans les productions discursives empiriques et/ou scientifiques, dans la forme que recouvrent les structures cognitives reproduites par habitus, par idéologie, voire par mimétisme. C’est bien cela l’épidémythe scientifique africaine. Comme un virus coronarien, cette épidémythe est invisible et fait prospérer l’état de végétation symbolique de l’Afrique qui ne peut, en conséquence, rien offrir au monde qui soit significatif de ses sémiotiques et de leurs métaphysiques !
Encore faut-il revenir sur le concept d’épidémythe emprunté à Emmanuelle Nguema Minko, qui elle-même le reprend à Jean-Loup Amselle. Dans « Le Kongossa [14] virus », l’auteure explique que la pandémie coronarienne a ramené, voire réduit les pathologies « réelles » ou « fictives » du Covid-19 à la réalité substantielle d’une métaphore épistémologique. Ainsi pense-t-elle que les mythes du « kongossa numérique » produits sur les réseaux sociaux africains ont une valeur épistémologique, dont les « croyances [sont] relatives à une idéologie de la résistance », ses « discours » se propageant dans « l’espace virtuel à la même allure » que la dernière version des virus coronariens ayant soumis la planète à l’objectivité de son pouvoir destructeur et mortel. Production, propagation, sémantisation et communautarisation des expériences et du sens : voici l’arrière-plan d’immanence constituant la syntaxe apparente des épidémythes en/sur l’Afrique : dès lors, qu’importe que ces épidémythes ressortissent aux croyances scientifiques, politiques, journalistiques, sociales ou religieuses, voire imaginaires [15].
S’il est vrai que la résilience africaine face au coronavirus Sars-Cov 2 a été vantée par les Africains eux-mêmes, soit à travers des discours hostiles à l’Occident et aux institutions internationales, soit à travers leur capacité à résorber le Covid-19 à travers des médicamentations propres, il ne demeure pas moins que cette résilience est demeurée un objet de curiosité intellectuelle pour les médias, les universitaires et autres institutions européennes. A tout le moins, les épidémythes qui en ressortent, en Afrique comme dans les pays du nord, ont désormais une double fonction imaginaire : d’une part, celle de déformer la réalité historique par les discours savants, journalistiques et/ou politiques qu’un virus en quête de corps à qui donner la mort vient remettre violemment en cause, au point de s’appeler à moins d’« arrogance » et à plus d’« humilité ». D’autre part, leur fonction la plus décisive est celle selon laquelle l’imaginaire du chaos qui en découle se déploie, mutatis mutandis, en une sorte d’optique déformant le sens même du monde, de sa géopolitique économique et sanitaire, autour de laquelle, depuis des siècles, s’écrivent et se consomment des contre-sens permanents à propos de l’Afrique, et dans laquelle s’empêtre le développement humain, social, politique et culturel du continent « noir ». Et cela saute dorénavant aux yeux avec l’évidence d’une réalité diurne. Les épidémythes africaines, qu’elles soient le fruit des imaginaires du nord ou ceux du sud, n’ont eu et n’ont pour vocation qu’à produire du relativisme, sorte de pensée oblongue érigée en vérité instrumentale aux effets catastrophiques, du moins quant au rôle qu’aurait pu et/ou doit jouer l’université en Afrique. La fracture scientifique dont parle Bonaventure Mvé-Ondo est l’incarnation de cette catastrophe induite par les praxis africaine et occidentale quant à leurs saisies de l’Afrique comme concept [16] et à la survivance de ce concept dans la vie mentale et psychologique des populations mondiales.
Au mieux, comme le pense Joseph Tonda, on n’a plus à espérer que les pratiques universitaires qui en découlent induisent un changement de paradigmes et d’attitude intellectuelle. Ce cas de figure rend compréhensible la réduction à laquelle nous les soumettons, pour nos besoins de carrières universitaires ou politiques. Ainsi prospère toujours l’impossible décolonisation des sciences humaines et sociales, celles-ci devenant la principale dystopie de notre développement, par renoncement à notre capacité d’abstraire notre réel aux fins de le rendre non pas intelligible aux sens mais aux raisons africaine et occidentale qui ont en commun des fondements logiques de la pensée [17]. L’absence de débat et le silence quasi assourdissant de la présence intellectuelle africaine dans l’analyse des pathologies coronariennes et de leurs effets délétères sur les sociétés africaines est à ce point significatif. On peut arguer de quelques initiatives prises ici ou là, mais le masque reste suffisamment inefficace pour stopper l’effet de désastre qu’entraîne le silence critique des sciences humaines et sociales africaines face à la gigantesque pagaille et au sacré désordre que le corona du Covid-19 a imposés au continent. Dans ce numéro, seulement quatre contributions sur quinze en ont fait un objet d’étude ! A ce silence, on associe une pensée nécessiteuse, fonctionnelle, et surtout déresponsabilisante. Et cela laisse prospérer l’idée que la connaissance objective des réalités assorties aux pathologies coronariennes en Afrique reste en attente des productions septentrionales pour qu’enfin les universitaires du sud en fassent un « objet » pertinent !
Ce décrochage avec la synchronie du coronavirus Covid-19 explique à elle seule la fracture scientifique dont nous nous nourrissons et qui en retour se nourrit du comportement scientifique africain pusillanime. Puisque les sciences humaines et sociales sur les terrains africains ne servent à rien, et politiquement, et anthropologiquement, et économiquement, etc., autant qu’elles aident au moins à construire des carrières ou des visibilités. Qu’importent alors ce que nous entendons par « construire », et que nous engendrons comme dystopie systémique dans les constructions scientifiques déployées en théories ! En soixante ans d’indépendance, la réduction du sens et des sciences à la fabrique des carrières et des perceptions erronées de nous-mêmes (cf. la critique de Mudimbe dans L’odeur du père), qui tiennent à une cumulation de textes dont personne ne se souvient ou ne se souviendra après leurs diffusions, à quelques exceptions près, se résout toujours à la même équation dans l’Etat postcolonial : « to be or not to be » ?
Au pire, on comprend le danger que fait peser nos pensées, en tant qu’annexes de la pensée occidentale. Prendre distance avec elles, c’est commencer à désapprendre à pointer la responsabilité du monde dit libre dans l’échec de notre développement politique et social. Inverser cette obsession sans que cela ne paraisse comme un leitmotiv viendrait à admettre les limites dans notre rapport au savoir et aux philosophies pragmatistes auxquelles cette obsession se subordonne. Au tout le moins, ces dernières obligent au doute quand-même, et conduisent à s’interroger si la voie choisie est la meilleure pour nous et pour le monde.
La résilience africaine mise à nue par le Sars-Cov 2, qui a contredit toutes les prédictions macabres et mortifères de ceux qui continuent à s’autoriser le droit de parler au nom de l’Afrique, invoque cette distorsion d’optique épidémythique, à laquelle seule une pensée assumée comme telle peut contenir à long terme ; du moins si elle s’en donne les moyens autour d’une doctrine scientifique toujours absente dans l’Etat postcolonial africain et ses universités.
Les épidémythes en/sur l’Afrique prospéreront sans doute. Mais sur l’océan d’incertitudes qu’a ouvert l’ère qu’Emmanuel M. Banywesize désigne « politique de la différenciation raciale », rien ne semble acquis d’avance !
« Différenciation », le mot/concept nous parle. Comme le monde, Les Editions Oudjat en Ligne ont été vulnérabilisées. Elles sont dans l’exacte posture des personnes âgées dont les images violentes venues d’Italie, de France, d’Espagne, des Etats-Unis, du Brésil ont bouleversé notre rapport aussi bien à l’humanisme classique qu’à l’humanité partagée. Elles ont aussi vécu une vulnérabilité due au Sars-Cov 2, à laquelle ont été exposés les migrants congolais du Gabon. Mais au lieu d’en pâtir ou de se replier dans la douleur, elles ont préféré l’action : vivre et écrire, ou alors, écrire en vivant dans la souffrance pour tenir la route comme « l’homme qui marche » (Giacometti) vers un non-sens mortifère devenu commune à l’humanité.
L’insoumission à Thanatos : c’est exactement la posture radicale assumée par Emmanuel M. Banywesize atteint par le Coronavirus du Sars-Cov 2, au sortir de son entretien infini avec la mort dans un hôtel du Congo-Brazzaville, à partir d’où il été transféré à Kinshasa (RDC), lieu dans lequel il a subi l’extrême épreuve de l’isolement et de traitement médical. Au bout de cette expérience-limite, le philosophe de Lubumbashi nous a proposé un « plaidoyer pour une politique de la vie » qui soit fondée sur l’élévation de la dignité humaine et de sa revalorisation par le capital. Il puise dans l’en-commun, concept cher à la philosophie bantu, les raisons d’espérer en un monde meilleur et solidaire. Plutôt la vie que la mort, la résilience que l’abandon de soi pour davantage protéger ce sens commun à l’humain, ce liant qui fasse que l’Homme soit la plus courte distance à l’homme !
Cette épidémythe-là a fait sens dans notre temps coronarien. Chaque année, la revue en ligne avait pris l’habitude d’organiser un colloque d’où elle tirait son numéro thématique. Le contexte mondial actuel lui a été éprouvant, hostile. C’est pourquoi nous avons opté pour un volume double rapatrié dans le numéro libre sous six centres d’intérêt thématiques distincts : a) les études dues à la pandémie du Covid-19 dans lesquelles on retrouve les contributions d’Emmanuel M. Banywesize, Armel Ovono, Parfait Mihindou Boussougou et Emmanuelle Nguema Minko ; b) on y trouve également des contributions intéressées aux problématiques d’interférences linguistiques et de représentations symboliques chez les apprenants bilingues et chez les étudiants de parcours Licence 1 à l’Université Omar Bongo. Marie-France Andème Allogo, Orphée Mavioga Soumaho et Mesmin Noël Soumaho en fournissent les textes ; c) l’archélogie gabonaise s’invite dans ce quatrième numéro. On lui doit les textes de Jean-Louis Boussougou, Jean de Capistran Aboghe Bengone et Fereole Clarpin Moussound ; d) l’économie politique et les études environnementales apparaissent également dans ce numéro, sous les plumes d’Alain Boussougou et Noël Ovono Edzand ; e) les contributions de Marius Bavekoumbou et Syntyche Assa Assa donnent à ce volume une double dimension littéraire à travers des études sémiotique et postcoloniale des œuvres d’auteurs aussi divers que Maurice Okouba Nkoghe et Maryse Condé. Enfin, la dernière thématique, généraliste à souhait, intègre une diversité de problématiques non nécessairement liées, au regard des champs et des disciplines qu’elle exploite, mais à tout le moins constitutifs d’un paradigme : l’état de la société africaine contemporaine dans son rapport à la modernité occidentale qui lui sert d’aiguillon politique, économique et culturelle. Dans la thématique désignée f) dynamiques sociales et politiques, on trouvera en effet les contributions d’Aude Carine Moussa Mouloungui, Jonas Charles Ndeke et Conchita Nelya Dinguenza Nzietsi sur l’entreprenariat au Gabon, la mobilisation politique au Congo-Brazzaville et la situation sécuritaire en République Centrafricaine.
Dans la jeune histoire de la revue Oudjat en Ligne, ce quatrième numéro s’édite à un moment pivot : celui de grands changements qui se bousculent à l’horizon, fruits d’interactions avec de nombreux acteurs des universités africaines et occidentales. On ne peut que saluer avec chaleureuses considérations les rencontres internationales organisées à Libreville, aussi bien à l’Université Omar Bongo (UOB), au Campus numérique de Libreville (CNFL) et au bureau régional de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui ont été les cadres d’accueil et d’échanges multidisciplinaires de très grande qualité scientifique. Les Editions Oudjat en Ligne remercient également les participants à tous les colloques de Libreville (2018 et 2019), ainsi que l’ensemble des contributeurs des numéros thématiques et libres 1, 2, 3 et 4 pour leurs contributions quant à la consolidation de cette œuvre commune. En effet, notre plateforme numérique connaît un taux de connexion élevé, en dépit d’une publicisation non conventionnelle et au demeurant confidentielle. Cette interactivité conforte non seulement leur choix éditorial, mais aussi la stratégie qui la commande.
Si les années de naissance de cet outil scientifique numérique se sont confondues avec notre volonté de faire communauté, il ne demeure pas moins que cet objectif tarde toujours à prendre corps. La principale raison est qu’en Afrique, la science appartient à son auteur, et pas à la communauté qu’elle se destine, ni aux interactions qu’elle est susceptible d’engendrer, aussi bien en termes formels, méthodologiques, qu’en termes épistémologique et éditorial. Trop souvent, nombre d’auteurs se sont laissé abuser par l’idée que Les Editions Oudjat en Ligne étaient un service postal où il suffit de « placer » un texte à publier. Notre ambition est de dépasser ce premier écueil, mais aussi l’économie de frustrations née du respect strict de nos critères de publication. Il s’agit de faire comprendre aux uns et aux autres que nos ambitions ne sont pas contraires à la volonté des chercheurs, pourvu que s’instaure un dialogue scientifique franc, à la fois productif et significatif, dans le sens des intérêts personnels et collectifs, en conformité avec notre ligne éditoriale disponible sur notre site www.editionsoudjat.org, en page d’accueil. De sorte que nous partagions un ensemble de valeurs humaines, professionnelles et scientifiques dans la contradiction et le débat nécessaires à une meilleure tension vers la vérité (R. Barthes, op. cit.).
C’est avec cette philosophie éditoriale que compte se poursuivre le travail réflexif sur l’Afrique implémenté par notre plateforme numérique, avec pour seul carburant la passion.
Ainsi notre plan de développement suppose-t-il des ruptures, de changements d’habitude, et surtout plus d’exigences à l’égard des ambitions initiales. Ces changements toucheront bientôt à la forme visuelle et au professionnalisme que nous attendons construire dans nos relations aux auteurs et autres acteurs producteurs de savoirs d’Afrique et du reste du monde. Pareillement, nous attendons de nos soutiens institutionnels davantage d’appui pour oser rêver plus grand : construire une science africaine épistémologiquement moins dépendante et capable de se comprendre différemment avec les outils cognitifs qui lui ont été historiquement transmis par le système universitaire mondial.
En attendant que ce rêve prenne corps, et que l’utopie qui en irrigue la pensée continue de prendre forme, nous invitons contributeurs et lecteurs à poursuivre le combat pour la vie et pour le sens.
Ces temps critiques nous l’imposent.
Georice Berthin Madébé
Directeur Administratif et Scientifique des OeL
Pour citer cet éditorial : Georice Berthin Madébé, « Epidémythes Africaines. Doutons-nous quand-même, en dépit du bon sens », Editorial Revue Oudjat en Ligne, numéro 4, volumes 1 & 2, janvier 2021, L’Afrique en temps de pandémie. Vivre et écrire à l’ère du Covid-19, ISBN : 978-2-912603-98-2/EAN : 9782912603982.
[1] Paris, L’Harmattan, 1993.
[2] Martin Bernal, Les racines afro-asiatique de la civilisation classique. Volume 1 : L’invention de la Grèce antique, Paris, PUF, 1996.
[3] V.Y. Mudimbe, L’odeur du père. Essai sur des limites des sciences et de la vie en Afrique noire, Paris, Présence Africaine, 1973.
[4] Isabelle Klock-Fontanille, « Y-a-t-il une science de l’écriture africaine ? Téléologie phonocentriste et pratiques africaines de l’écriture », Revue Oudjat en Ligne, numéro 3, volume 1, janvier 2020. Actes du Colloque international de Libreville : L’Afrique au XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et doctrines scientifiques, Haut de Gué-gué, du 26 au 28 juin 2019.
[5] Pour Unesco Science Report, 2010. The Current Status of Science around the World, le développement de la culture scientifique en Afrique reste très préoccupant 2008 (p. 13).
[6] Georges Moussavou, Organisation et système universitaire au Gabon. Sociologie des processus et systèmes institutionnels au Gabon, Paris, L’Harmattan, 2020.
[7] Bonaventure Mvé-Ondo, A chacun sa raison. Raison occidentale et raison africaine, Paris, L’Harmattan, 2013.
[8] Bonaventure Mvé-Ondo, Afrique. La fracture scientifique, Paris, Futuribles, 2005, p. 23 & 25.
[9] Joseph Tonda , « L’impossible décolonisation des sciences sociales africaines », Mouvements, 2012/4 n° 72, cf. https://www.cairn.info/revue-mouvements-2012-4-page-108.htm, pages 108 à 119.
[10] Kwasi Wiredu, « La nécessité d’une décolonisation conceptuelle en philosophie africaine », in De(s) générations, numéro 23, 2015.
[11] Walter Mignolo , « Géopolitique de la connaissance, colonialité du pouvoir et différence coloniale, in Multitudes, 2001/3 n° 6, p. 56 à 71. Consulté le 11/10/2019 à 20:50.
[12] Paul Du Chaille , L’Afrique sauvage. Nouvelles excursions au pays des Ashangos, Paris, Michel Lévy Frères, 1868.
[13] Patrice Yengo, Les mutations sorcières dans le bassin du Congo. Du ventre et de sa politique, Paris, Karthala, 2016.
[14] « Kongossa » : terme populaire gabonais équivalent du français « rumeur ».
[15] A ce titre, les attaques menées contre Didier Raoult et tous les autres scientifiques contre le narratif officiel du coronavirus du Sars Cov 2, les démissions des scientifiques européens à la tête des agences de santé publique, et la revue The Lancet ont mis à mal l’équilibre moral qu’avaient construit jusqu’ici notre croyance aux sciences, à leur capacité à conduire le progrès social sur des bases désintéressées et notre commune faculté critique.
[16] V.Y. Mudimbe, The Invention of Africa : Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge, Indiana University Press, Bloomington, 1988.V.Y. Mudimbe, The Idea of Africa, Indiana University Press, 1994.
[17] Georice Berthin Madébé, « Structures (ant)agonistes du sens, 2. Epistémologie de l’Hanima et logique critique du Bwete », in Revue Oudjat en Ligne, numéro 3, volume 1, janvier 2020. Actes du Colloque international de Libreville : L’Afrique au XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et doctrines scientifiques, Haut de Gué-gué, du 26 au 28 juin 2019.
++L’Afrique en temps de pandémie. Vivre et écrire à l’ère du Covid-19Epidémythes Africaines.
Notre but était de fonder une collégialité et une collaboration scientifiques autour des paradigmes de recherche touchant prioritairement le continent dit « noir ». D’une certaine manière, les créateurs des Editions Oudjat en Ligne avaient saisi ce qui se passait, en l’occurrence le rapport que les sciences humaines et sociales entretiennent avec les terrains africains depuis leurs introductions dans le continent. Les initiateurs de ce qui n’était qu’un projet y percevaient comme une anomalie, un dysfonctionnement emprunté à l’intelligence des ouvrages destinés à expliquer l’Afrique, un continent sans culture ni tradition scientifique d’après le Selaf ; ce dysfonctionnement s’étendant désormais à une appropriation devenue ordinaire dans les écrits scientifiques des Africains eux-mêmes. Cette perception n’était ni nouvelle, ni originale. Elle est à l’origine de toute la pensée linguistique (lexicographique) d’un M.T. Zezeze Kalonji qui en avait fait le préalable à l’écriture de son livre : La lexicographie bilingue en Afrique francophone. L’exemple du français- cilubà [1]. Seulement, elle apparut aux concepteurs des OeL avec une telle « nudité » qu’ils s’en approprièrent pour en faire un objet de questionnement d’intérêt général. Cette démarche est celle qui avait déterminé l’esprit du Sénégalais Cheikh Anta Diop, dont les travaux recentrèrent l’intérêt des recherches menées en Afrique sur des problématiques propres. Notamment, à travers le développement d’une pensée critique en confrontations directes avec les concepts, les méthodes et les objets transmis aux Africains par la situation coloniale. La question de « l’antériorité des civilisations nègres » mettait en effet à l’épreuve de nombreux acquis, de nombreux discours, au point que Diop en vint à repenser l’égyptologie d’alors autour d’une systémique combinant linguistique historique et comparée, anthropologie, histoire, physique, etc., pour donner corps à ce que tous les égyptologues contemporains les plus sérieux admettent comme une lapalissade [2]. Mais c’est avec V.Y. Mudimbe qu’apparaît une critique fondée de la métaphysique des sciences humaines et sociales et de la pertinence de leurs usages sur les terrains « noirs ». Cette critique tient à deux inflexions majeures, d’origines philosophique et anthropologique. D’une part, le mimétisme des études africaines déployées par ceux qui avaient pour fonction de produire la science et de dire, à travers leurs écrits, le sens concret de la « pensée sauvage » et de sa métaphysique. Pour Mudimbe, cette critique est moins sévère, car elle résulte de la faiblesse ontologique des sciences humaines et sociales, lesquelles présentent des « limites critiques » face aux expressions de la vie en Afrique. D’autre part, la praxis imaginaire, sociologique, anthropologique et politique africaine, pensait-il dans L’odeur du père [3], contient en quelque sorte les présupposés initiaux qui avaient conduit à la production de leurs épistémologies dominées, en occident, par une volonté de puissance traduite par la maîtrise de la nature (A. Berque, Œcoumène), et/ou de la Nature (d’Isaac Newton à Max Planck, et Max Planck à Stephen Hawking). Mais le contexte européen, favorable à l’érection des méthodes scientifiques dites critiques, avait laissé prospérer dans la conscience collective l’idée de sciences neutres, froides et distantes avec leurs objets. Contaminées par cette vague, les sciences humaines et sociales devaient elles aussi se garantir une certaine objectivité scientifique. Les pratiques réflexives ainsi renouvelées devaient aider les communautés savantes à prendre congé des logiques empiristes de la critique du vivant en cours dans les universités occidentales héritières de la philologie et des approches historicistes (R. Barthes, Critique et vérité). Ainsi, dans les années soixante jusqu’aux années quatre-vingt-dix, on eut droit à une diversité d’ouvrages portant sur les questions de procédures scientifiques, que d’aucuns avaient désigné par le vocable de structuralisme, voire d’épistémologie. Jusque dans un passé encore récent, on avait cru à l’idée d’une épistémologie générale froide, non partisane, et même non paternaliste. Si l’idée peut être défendue et soutenue, elle a néanmoins montré ses limites. Le droit de douter et de critiquer la présence des sciences sur les terrains africains repose sur les usages qu’en ont faits nombre d’acteurs. L’euphorie et la croyance, presque naïves au pouvoir épistémologisant des discours scientifiques appliqués aux terrains africains eurent en effet de nombreux dégâts, fruits à la fois de l’ethnologie et des ethnosciences, et des téléologies phonocentristes [4]. Le monde contemporain, et l’Afrique en particulier, paie le prix fort de cette culture relativiste : sur le plan critique, elle a développé des réflexes de subsidiarité au point que les personnels scientifiques africains, consciemment ou non, ont développé de réflexes de subordination épistémologique vis-à-vis de l’Occident, développant ainsi chez eux des sciences asymétriques. Sur le plan structurel, notre continent a renoncé à se doter d’infrastructures scientifiques compétitives, en matière d’université, de centre de recherche et de développement scientifique. La conséquence de tout cela est qu’il ne participe pour rien à la production des savoirs au niveau mondial [5]. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si la critique de Mudimbe reste toujours pertinente. Depuis son émergence, qu’ont fait les Etats africains, en général, et les universités du continent en particulier ? Que continuent-ils de faire de la science des autres pour se comprendre eux-mêmes ou aider le monde à comprendre l’Afrique à partir de ses propres discours critiques ? A l’échelle gabonaise, si l’on s’en tient à Organisation et système universitaire au Gabon. Sociologie des processus et systèmes institutionnels au Gabon [6] : « rien ». A l’échelle planétaire, la réponse de Bonaventure Mvé-Ondo est on ne peut plus claire. Le continent a développé une fracture scientifique qu’elle nourrit et dont elle se nourrit, à travers son incapacité à répondre à sa propre demande de développement en se fondant sur sa « raison » [7]. L’auteur d’Afrique. La fracture scientifique renchérit : « l’implantation de la science en Afrique vient accompagner l’effort d’économies extraverties fondées sur l’exportation des ressources naturelles. D’où une science restée ici au service exclusif des intérêts étrangers, confirmant du même coup la coexistence de deux modes : le mode de la tradition et celui de la modernité. Avec cette coexistence commence la marginalisation scientifique de l’Afrique » [8]. Cette « fracture », on la doit à certain rapport de domination qu’exerce toujours la science des librairies et bibliothèques occidentales, appuyées par une idéologie de la puissance soutenue par un discours masse médiatique, bureaucratique et diplomatique de divers ordres. Ceci a pour conséquence psychologique l’inhibition des initiatives individuelles et/ou collectives, la croyance aux discours savants en provenance du nord et la négligence des écrits scientifiques du sud, ou leur endiguement par un soft power très persuasif : bourses de coopération, commandes de travaux spécifiques, prescriptions des centres d’intérêts d’études et de recherche qu’accompagnent des soutiens à la mobilité des chercheurs africains multiformes, etc. Comme l’explique Bonaventure Mvé-Ondo, tout cela se faisant au profit exclusif des agences et laboratoires des Etats occidentaux qui en fournissent les moyens financiers, et au détriment de l’Afrique qui, à l’occasion, perd une grande part de ses élites universitaires du coup captés par le système international de recherche. Pour ainsi dire, la dépendance des savoirs et pratiques scientifiques dont l’Afrique se nourrit et qui hypertrophie la fracture scientifique entre elle et le reste du monde, travaille implicitement ou explicitement à appauvrir l’émergence d’une pensée autonome, repliée sur elle-même et ses objets de façon symétrique, au profit exclusif du développement du continent. D’elle dépend la « décolonisation des sciences humaines » [9] analysée par Joseph Tonda, ou la « nécessité d’une décolonisation conceptuelle », telle que le défend Kwasi Wiredu [10]. L’épidémythe scientifique africaine tient à cela, en la croyance d’une science universelle reconnaissable à des concepts et à des méthodes partout ailleurs opérationnels, et qui ignore la géographie des savoirs, la colonialité épistémologique et ce que celles-ci impliquent pour l’épistémologie classique [11]. Cette croyance, comme celles générées par la pandémie coronarienne qui frappe la planète depuis mars 2020, rappelle nécessairement d’autres mythes, en l’occurrence ceux de l’Occident civilisé sur l’« Afrique sauvage » [12], et ceux que l’Afrique elle-même produit de manière irréflexive [13] quand elle entreprend de s’interroger à partir des sciences humaines et sociales. Cette asymétrie épistémologique et métaphysique, on la trouve partout dans les productions discursives empiriques et/ou scientifiques, dans la forme que recouvrent les structures cognitives reproduites par habitus, par idéologie, voire par mimétisme. C’est bien cela l’épidémythe scientifique africaine. Comme un virus coronarien, cette épidémythe est invisible et fait prospérer l’état de végétation symbolique de l’Afrique qui ne peut, en conséquence, rien offrir au monde qui soit significatif de ses sémiotiques et de leurs métaphysiques ! Encore faut-il revenir sur le concept d’épidémythe emprunté à Emmanuelle Nguema Minko, qui elle-même le reprend à Jean-Loup Amselle. Dans « Le Kongossa [14] virus », l’auteure explique que la pandémie coronarienne a ramené, voire réduit les pathologies « réelles » ou « fictives » du Covid-19 à la réalité substantielle d’une métaphore épistémologique. Ainsi pense-t-elle que les mythes du « kongossa numérique » produits sur les réseaux sociaux africains ont une valeur épistémologique, dont les « croyances [sont] relatives à une idéologie de la résistance », ses « discours » se propageant dans « l’espace virtuel à la même allure » que la dernière version des virus coronariens ayant soumis la planète à l’objectivité de son pouvoir destructeur et mortel. Production, propagation, sémantisation et communautarisation des expériences et du sens : voici l’arrière-plan d’immanence constituant la syntaxe apparente des épidémythes en/sur l’Afrique : dès lors, qu’importe que ces épidémythes ressortissent aux croyances scientifiques, politiques, journalistiques, sociales ou religieuses, voire imaginaires [15]. S’il est vrai que la résilience africaine face au coronavirus Sars-Cov 2 a été vantée par les Africains eux-mêmes, soit à travers des discours hostiles à l’Occident et aux institutions internationales, soit à travers leur capacité à résorber le Covid-19 à travers des médicamentations propres, il ne demeure pas moins que cette résilience est demeurée un objet de curiosité intellectuelle pour les médias, les universitaires et autres institutions européennes. A tout le moins, les épidémythes qui en ressortent, en Afrique comme dans les pays du nord, ont désormais une double fonction imaginaire : d’une part, celle de déformer la réalité historique par les discours savants, journalistiques et/ou politiques qu’un virus en quête de corps à qui donner la mort vient remettre violemment en cause, au point de s’appeler à moins d’« arrogance » et à plus d’« humilité ». D’autre part, leur fonction la plus décisive est celle selon laquelle l’imaginaire du chaos qui en découle se déploie, mutatis mutandis, en une sorte d’optique déformant le sens même du monde, de sa géopolitique économique et sanitaire, autour de laquelle, depuis des siècles, s’écrivent et se consomment des contre-sens permanents à propos de l’Afrique, et dans laquelle s’empêtre le développement humain, social, politique et culturel du continent « noir ». Et cela saute dorénavant aux yeux avec l’évidence d’une réalité diurne. Les épidémythes africaines, qu’elles soient le fruit des imaginaires du nord ou ceux du sud, n’ont eu et n’ont pour vocation qu’à produire du relativisme, sorte de pensée oblongue érigée en vérité instrumentale aux effets catastrophiques, du moins quant au rôle qu’aurait pu et/ou doit jouer l’université en Afrique. La fracture scientifique dont parle Bonaventure Mvé-Ondo est l’incarnation de cette catastrophe induite par les praxis africaine et occidentale quant à leurs saisies de l’Afrique comme concept [16] et à la survivance de ce concept dans la vie mentale et psychologique des populations mondiales. Au mieux, comme le pense Joseph Tonda, on n’a plus à espérer que les pratiques universitaires qui en découlent induisent un changement de paradigmes et d’attitude intellectuelle. Ce cas de figure rend compréhensible la réduction à laquelle nous les soumettons, pour nos besoins de carrières universitaires ou politiques. Ainsi prospère toujours l’impossible décolonisation des sciences humaines et sociales, celles-ci devenant la principale dystopie de notre développement, par renoncement à notre capacité d’abstraire notre réel aux fins de le rendre non pas intelligible aux sens mais aux raisons africaine et occidentale qui ont en commun des fondements logiques de la pensée [17]. L’absence de débat et le silence quasi assourdissant de la présence intellectuelle africaine dans l’analyse des pathologies coronariennes et de leurs effets délétères sur les sociétés africaines est à ce point significatif. On peut arguer de quelques initiatives prises ici ou là, mais le masque reste suffisamment inefficace pour stopper l’effet de désastre qu’entraîne le silence critique des sciences humaines et sociales africaines face à la gigantesque pagaille et au sacré désordre que le corona du Covid-19 a imposés au continent. Dans ce numéro, seulement quatre contributions sur quinze en ont fait un objet d’étude ! A ce silence, on associe une pensée nécessiteuse, fonctionnelle, et surtout déresponsabilisante. Et cela laisse prospérer l’idée que la connaissance objective des réalités assorties aux pathologies coronariennes en Afrique reste en attente des productions septentrionales pour qu’enfin les universitaires du sud en fassent un « objet » pertinent ! Ce décrochage avec la synchronie du coronavirus Covid-19 explique à elle seule la fracture scientifique dont nous nous nourrissons et qui en retour se nourrit du comportement scientifique africain pusillanime. Puisque les sciences humaines et sociales sur les terrains africains ne servent à rien, et politiquement, et anthropologiquement, et économiquement, etc., autant qu’elles aident au moins à construire des carrières ou des visibilités. Qu’importent alors ce que nous entendons par « construire », et que nous engendrons comme dystopie systémique dans les constructions scientifiques déployées en théories ! En soixante ans d’indépendance, la réduction du sens et des sciences à la fabrique des carrières et des perceptions erronées de nous-mêmes (cf. la critique de Mudimbe dans L’odeur du père), qui tiennent à une cumulation de textes dont personne ne se souvient ou ne se souviendra après leurs diffusions, à quelques exceptions près, se résout toujours à la même équation dans l’Etat postcolonial : « to be or not to be » ? Au pire, on comprend le danger que fait peser nos pensées, en tant qu’annexes de la pensée occidentale. Prendre distance avec elles, c’est commencer à désapprendre à pointer la responsabilité du monde dit libre dans l’échec de notre développement politique et social. Inverser cette obsession sans que cela ne paraisse comme un leitmotiv viendrait à admettre les limites dans notre rapport au savoir et aux philosophies pragmatistes auxquelles cette obsession se subordonne. Au tout le moins, ces dernières obligent au doute quand-même, et conduisent à s’interroger si la voie choisie est la meilleure pour nous et pour le monde. La résilience africaine mise à nue par le Sars-Cov 2, qui a contredit toutes les prédictions macabres et mortifères de ceux qui continuent à s’autoriser le droit de parler au nom de l’Afrique, invoque cette distorsion d’optique épidémythique, à laquelle seule une pensée assumée comme telle peut contenir à long terme ; du moins si elle s’en donne les moyens autour d’une doctrine scientifique toujours absente dans l’Etat postcolonial africain et ses universités. Les épidémythes en/sur l’Afrique prospéreront sans doute. Mais sur l’océan d’incertitudes qu’a ouvert l’ère qu’Emmanuel M. Banywesize désigne « politique de la différenciation raciale », rien ne semble acquis d’avance ! « Différenciation », le mot/concept nous parle. Comme le monde, Les Editions Oudjat en Ligne ont été vulnérabilisées. Elles sont dans l’exacte posture des personnes âgées dont les images violentes venues d’Italie, de France, d’Espagne, des Etats-Unis, du Brésil ont bouleversé notre rapport aussi bien à l’humanisme classique qu’à l’humanité partagée. Elles ont aussi vécu une vulnérabilité due au Sars-Cov 2, à laquelle ont été exposés les migrants congolais du Gabon. Mais au lieu d’en pâtir ou de se replier dans la douleur, elles ont préféré l’action : vivre et écrire, ou alors, écrire en vivant dans la souffrance pour tenir la route comme « l’homme qui marche » (Giacometti) vers un non-sens mortifère devenu commune à l’humanité. L’insoumission à Thanatos : c’est exactement la posture radicale assumée par Emmanuel M. Banywesize atteint par le Coronavirus du Sars-Cov 2, au sortir de son entretien infini avec la mort dans un hôtel du Congo-Brazzaville, à partir d’où il été transféré à Kinshasa (RDC), lieu dans lequel il a subi l’extrême épreuve de l’isolement et de traitement médical. Au bout de cette expérience-limite, le philosophe de Lubumbashi nous a proposé un « plaidoyer pour une politique de la vie » qui soit fondée sur l’élévation de la dignité humaine et de sa revalorisation par le capital. Il puise dans l’en-commun, concept cher à la philosophie bantu, les raisons d’espérer en un monde meilleur et solidaire. Plutôt la vie que la mort, la résilience que l’abandon de soi pour davantage protéger ce sens commun à l’humain, ce liant qui fasse que l’Homme soit la plus courte distance à l’homme ! Cette épidémythe-là a fait sens dans notre temps coronarien. Chaque année, la revue en ligne avait pris l’habitude d’organiser un colloque d’où elle tirait son numéro thématique. Le contexte mondial actuel lui a été éprouvant, hostile. C’est pourquoi nous avons opté pour un volume double rapatrié dans le numéro libre sous six centres d’intérêt thématiques distincts : a) les études dues à la pandémie du Covid-19 dans lesquelles on retrouve les contributions d’Emmanuel M. Banywesize, Armel Ovono, Parfait Mihindou Boussougou et Emmanuelle Nguema Minko ; b) on y trouve également des contributions intéressées aux problématiques d’interférences linguistiques et de représentations symboliques chez les apprenants bilingues et chez les étudiants de parcours Licence 1 à l’Université Omar Bongo. Marie-France Andème Allogo, Orphée Mavioga Soumaho et Mesmin Noël Soumaho en fournissent les textes ; c) l’archélogie gabonaise s’invite dans ce quatrième numéro. On lui doit les textes de Jean-Louis Boussougou, Jean de Capistran Aboghe Bengone et Fereole Clarpin Moussound ; d) l’économie politique et les études environnementales apparaissent également dans ce numéro, sous les plumes d’Alain Boussougou et Noël Ovono Edzand ; e) les contributions de Marius Bavekoumbou et Syntyche Assa Assa donnent à ce volume une double dimension littéraire à travers des études sémiotique et postcoloniale des œuvres d’auteurs aussi divers que Maurice Okouba Nkoghe et Maryse Condé. Enfin, la dernière thématique, généraliste à souhait, intègre une diversité de problématiques non nécessairement liées, au regard des champs et des disciplines qu’elle exploite, mais à tout le moins constitutifs d’un paradigme : l’état de la société africaine contemporaine dans son rapport à la modernité occidentale qui lui sert d’aiguillon politique, économique et culturelle. Dans la thématique désignée f) dynamiques sociales et politiques, on trouvera en effet les contributions d’Aude Carine Moussa Mouloungui, Jonas Charles Ndeke et Conchita Nelya Dinguenza Nzietsi sur l’entreprenariat au Gabon, la mobilisation politique au Congo-Brazzaville et la situation sécuritaire en République Centrafricaine. Dans la jeune histoire de la revue Oudjat en Ligne, ce quatrième numéro s’édite à un moment pivot : celui de grands changements qui se bousculent à l’horizon, fruits d’interactions avec de nombreux acteurs des universités africaines et occidentales. On ne peut que saluer avec chaleureuses considérations les rencontres internationales organisées à Libreville, aussi bien à l’Université Omar Bongo (UOB), au Campus numérique de Libreville (CNFL) et au bureau régional de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui ont été les cadres d’accueil et d’échanges multidisciplinaires de très grande qualité scientifique. Les Editions Oudjat en Ligne remercient également les participants à tous les colloques de Libreville (2018 et 2019), ainsi que l’ensemble des contributeurs des numéros thématiques et libres 1, 2, 3 et 4 pour leurs contributions quant à la consolidation de cette œuvre commune. En effet, notre plateforme numérique connaît un taux de connexion élevé, en dépit d’une publicisation non conventionnelle et au demeurant confidentielle. Cette interactivité conforte non seulement leur choix éditorial, mais aussi la stratégie qui la commande. Si les années de naissance de cet outil scientifique numérique se sont confondues avec notre volonté de faire communauté, il ne demeure pas moins que cet objectif tarde toujours à prendre corps. La principale raison est qu’en Afrique, la science appartient à son auteur, et pas à la communauté qu’elle se destine, ni aux interactions qu’elle est susceptible d’engendrer, aussi bien en termes formels, méthodologiques, qu’en termes épistémologique et éditorial. Trop souvent, nombre d’auteurs se sont laissé abuser par l’idée que Les Editions Oudjat en Ligne étaient un service postal où il suffit de « placer » un texte à publier. Notre ambition est de dépasser ce premier écueil, mais aussi l’économie de frustrations née du respect strict de nos critères de publication. Il s’agit de faire comprendre aux uns et aux autres que nos ambitions ne sont pas contraires à la volonté des chercheurs, pourvu que s’instaure un dialogue scientifique franc, à la fois productif et significatif, dans le sens des intérêts personnels et collectifs, en conformité avec notre ligne éditoriale disponible sur notre site www.editionsoudjat.org, en page d’accueil. De sorte que nous partagions un ensemble de valeurs humaines, professionnelles et scientifiques dans la contradiction et le débat nécessaires à une meilleure tension vers la vérité (R. Barthes, op. cit.). C’est avec cette philosophie éditoriale que compte se poursuivre le travail réflexif sur l’Afrique implémenté par notre plateforme numérique, avec pour seul carburant la passion. Ainsi notre plan de développement suppose-t-il des ruptures, de changements d’habitude, et surtout plus d’exigences à l’égard des ambitions initiales. Ces changements toucheront bientôt à la forme visuelle et au professionnalisme que nous attendons construire dans nos relations aux auteurs et autres acteurs producteurs de savoirs d’Afrique et du reste du monde. Pareillement, nous attendons de nos soutiens institutionnels davantage d’appui pour oser rêver plus grand : construire une science africaine épistémologiquement moins dépendante et capable de se comprendre différemment avec les outils cognitifs qui lui ont été historiquement transmis par le système universitaire mondial. En attendant que ce rêve prenne corps, et que l’utopie qui en irrigue la pensée continue de prendre forme, nous invitons contributeurs et lecteurs à poursuivre le combat pour la vie et pour le sens. Ces temps critiques nous l’imposent. Georice Berthin MadébéDirecteur Administratif et Scientifique des OeL
|
|
[1] Paris, L’Harmattan, 1993. [2] Martin Bernal, Les racines afro-asiatique de la civilisation classique. Volume 1 : L’invention de la Grèce antique, Paris, PUF, 1996. [3] V.Y. Mudimbe, L’odeur du père. Essai sur des limites des sciences et de la vie en Afrique noire, Paris, Présence Africaine, 1973. [4] Isabelle Klock-Fontanille, « Y-a-t-il une science de l’écriture africaine ? Téléologie phonocentriste et pratiques africaines de l’écriture », Revue Oudjat en Ligne, numéro 3, volume 1, janvier 2020. Actes du Colloque international de Libreville : L’Afrique au XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et doctrines scientifiques, Haut de Gué-gué, du 26 au 28 juin 2019. [5] Pour Unesco Science Report, 2010. The Current Status of Science around the World, le développement de la culture scientifique en Afrique reste très préoccupant 2008 (p. 13). [6] Georges Moussavou, Organisation et système universitaire au Gabon. Sociologie des processus et systèmes institutionnels au Gabon, Paris, L’Harmattan, 2020. [7] Bonaventure Mvé-Ondo, A chacun sa raison. Raison occidentale et raison africaine, Paris, L’Harmattan, 2013. [8] Bonaventure Mvé-Ondo, Afrique. La fracture scientifique, Paris, Futuribles, 2005, p. 23 & 25. [9] Joseph Tonda , « L’impossible décolonisation des sciences sociales africaines », Mouvements, 2012/4 n° 72, cf. https://www.cairn.info/revue-mouvements-2012-4-page-108.htm, pages 108 à 119. [10] Kwasi Wiredu, « La nécessité d’une décolonisation conceptuelle en philosophie africaine », in De(s) générations, numéro 23, 2015. [11] Walter Mignolo , « Géopolitique de la connaissance, colonialité du pouvoir et différence coloniale, in Multitudes, 2001/3 n° 6, p. 56 à 71. Consulté le 11/10/2019 à 20:50. [12] Paul Du Chaille , L’Afrique sauvage. Nouvelles excursions au pays des Ashangos, Paris, Michel Lévy Frères, 1868. [13] Patrice Yengo, Les mutations sorcières dans le bassin du Congo. Du ventre et de sa politique, Paris, Karthala, 2016. [14] « Kongossa » : terme populaire gabonais équivalent du français « rumeur ». [15] A ce titre, les attaques menées contre Didier Raoult et tous les autres scientifiques contre le narratif officiel du coronavirus du Sars Cov 2, les démissions des scientifiques européens à la tête des agences de santé publique, et la revue The Lancet ont mis à mal l’équilibre moral qu’avaient construit jusqu’ici notre croyance aux sciences, à leur capacité à conduire le progrès social sur des bases désintéressées et notre commune faculté critique. [16] V.Y. Mudimbe, The Invention of Africa : Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge, Indiana University Press, Bloomington, 1988.V.Y. Mudimbe, The Idea of Africa, Indiana University Press, 1994. [17] Georice Berthin Madébé, « Structures (ant)agonistes du sens, 2. Epistémologie de l’Hanima et logique critique du Bwete », in Revue Oudjat en Ligne, numéro 3, volume 1, janvier 2020. Actes du Colloque international de Libreville : L’Afrique au XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et doctrines scientifiques, Haut de Gué-gué, du 26 au 28 juin 2019. |


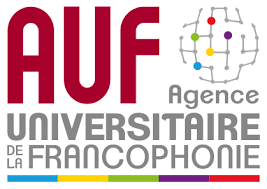
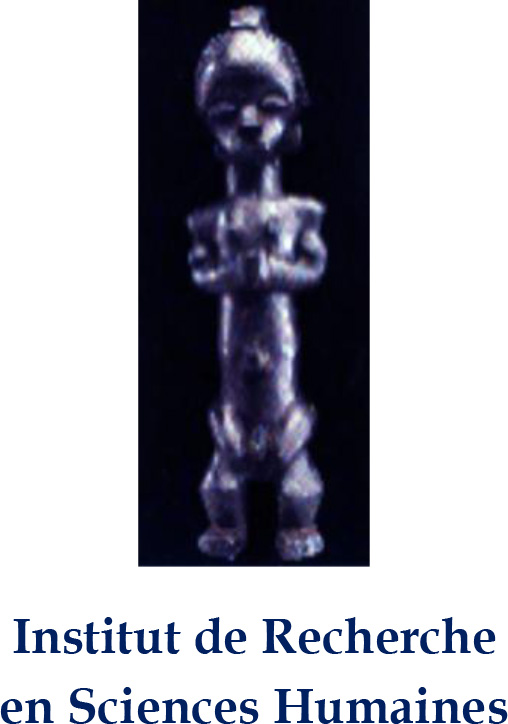 la penser ensemble...
la penser ensemble...