ACCUEIL
» PUBLICATIONS
» ANCIENS NUMEROS
» L’Afrique dans le XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et doctrines scientifiques, numéro 3, volume 1, janvier 2020
» Articles de ce numéro
AN = Du droit à la différence, à la différence de droit.
Christ-Olivier Mpaga,
Université Omar Bongo,
Département de philosophie,
Gabon
- « La démocratie n’est pas un modèle qu’il s’agirait de copier, mais un objectif qui doit être atteint par tous les peuples et assimilé par toutes les cultures. Elle peut prendre de nombreuses formes, suivant les caractéristiques propres et l’histoire de chaque société ».
Boutros Ghali (Doc. ONU A/50/332/1995)
Le droit à la différence doit être entendu ici comme la volonté des Etats africains de faire cohabiter les savoirs et pratiques endogènes avec la démocratie. C’est le droit comme prérogative permettant aux Etats de ce continent de se démocratiser en exprimant leur particularité ou encore leur spécificité. Mais, dans ce texte, nous entendrons aussi que ce droit à la différence ne peut pas être revendiqué s’il ne fait pas sens à partir d’une référence fondatrice, en l’occurrence celles des principes démocratiques. Quant aux principes démocratiques, nous les tirerons de la déclaration Universelle sur la démocratie. Celle-ci déclare en effet que la démocratie est universellement reconnue comme un idéal et un but, qu’elle est fondée sur des valeurs communes partagées par les peuples du monde malgré leurs différences culturelle, politique et économique. Dans sa pratique, et donc dans ce qui la distingue des autres systèmes de gouvernement, la démocratie s’entend comme le droit qu’a le peuple de participer à la gestion des affaires publiques. Par là, il faut comprendre que la légitimité et la légitimation du gouvernement et des pratiques de gouvernement émanent du peuple, comme le stipule « La Déclaration de Vienne sur les droits de l’homme » (1993). Enfin, la culture s’entendra ici « comme réalité de fait de conscience ou comme produit des effets de la réalité », au sens que lui donne Michel Cahen (1994, 64). Il s’agit là d’une définition de la culture comprise comme le fait pour une communauté humaine de prendre en charge collectivement son destin, et ce à partir de son historicité propre.
Dans la culture, selon Yvonne Verdier (1979, 81-82), « les termes mêmes de tradition, de coutume servent de référence et assoient ce qui se fait comme manifestation propre à la collectivité et sanctionnée par elle […] Cependant l’exigence normative de « faire la coutume » n’oblitère jamais l’événement. Tout au contraire, celui-ci nourrit la coutume ». Plus explicitement, la culture renverra ici aux traditions et coutumes qui en sont l’expression. La particularité de l’engagement démocratique en Afrique subsaharienne, par la cohabitation du politique et du culturel (tradition/coutume), d’une part, et par l’invention d’institutions positives supposés renforcer le contrôle démocratique, d’autre part, laisserait sous-entendre que les Etats de cette partie du continent pratiquent une rationalité démocratique contextualisées. Autrement dit, une forme de production proprement africaine de la modernité politique. Mais, ce sous-entendu mérite d’être évalué. Il s’agit de voir si la démocratie contextualisée par les Etats africains peut être considérée comme une invention ou ré-invention de la modernité politique.
Une première question s’impose alors : que signifie cette intervention du culturel dans l’espace démocratique africain, entendu que les Indépendances des Etats d’Afrique subsaharienne (francophone) se sont faites sous le modèle politique de l’Etat-nation laïc ? Ce modèle prône l’unité et l’indivisibilité de la nation par la seule reconnaissance de la citoyenneté, exit les affirmations identitaires dans l’espace publique. Deuxième question : quelle réalité de faits conduit les Etats africains à se démocratiser en inventant des institutions, à l’exemple, entre autres, des Commissions Nationales Electorales présentes dans la plupart de ces Etats ? L’Afrique inventerait ou réinventerait la modernité politique à la seule condition qu’elle prenne la mesure de ce en quoi consiste la notion d’invention, appliquée aussi bien à la culture qu’à ses institutions positives propres. Pour Jean-François Bayart (1983, 23-39), l’invention de la culture se rapporte à sa « dé-tropicalisation », c’est-à-dire en une remise en cause de la « mentalité primitive » ou « prélogique » (Lévy-Bruhl, 1922), par opposition à une « mentalité logique ». Rapportée à la notion d’invention de la modernité politique, cette assertion sous-entend que la culture (traditions et coutumes) ne doit pas nourrir l’évènement présent en Afrique, à savoir sa démocratisation. Cette invention suppose plutôt que c’est la démocratisation des Etats de ce continent qui doit nourrir la culture. C’est la raison pour laquelle Jean-François Bayart affirme (2009, 28) qu’« En Afrique comme ailleurs, il y a eu invention de la modernité par « invention de la tradition ». Bayart propose donc de commencer par inventer la culture. Fabien Eboussi Boulaga (1977, 145) nous donne une définition dans ce sens. Pour lui, la culture est « un être-ensemble et un avoir-en-commun qui appellent à une destinée commune par un agir-ensemble ». Cet agir-ensemble, nous dit Eboussi dans La Crise du Muntu (4e de couverture), commande d’« instaurer en Afrique Noire un discours philosophique, dépassant les obstacles qui oblitèrent encore son avènement ». Ce qui veut dire qu’inventer la modernité politique des Etats africains à partir de la culture, c’est regarder si ces acteurs politiques, en pratique, trouvent du sens dans la cohabitation des savoirs et pratiques endogènes avec la démocratie. La logique du sens de cette cohabitation vaut également lorsqu’il s’agit des institutions classiques de la démocratie avec les institutions positives africaines inventées.
Cependant, un constat général fait apparaitre que les formes de production endogène de la démocratie en Afrique ne sont que des tentatives de pacification de la crise de confiance permanente entre les gouvernants et les gouvernés. Ces tentatives n’ont malheureusement pas toujours atteint le but escompté. A tout le moins, elles n’ont pas pacifié, dans la longue durée, l’espace politique africain. La principale raison de cet échec est connue : c’est la subordination du principe démocratique aux usages intéressés de la tradition et des institutions. Ainsi, du bon droit à revendiquer un droit à la différence, on en vient malheureusement à revendiquer une différence de droit, donc à nier le principe même de l’universalisme démocratique. En Afrique, l’invention de la tradition et des institutions peuvent déboucher, en fonction du jeu des acteurs, sur une modernité politique ou, au contraire, sur une dictature, à l’exemple, entre autres chefs d’Etat, de Mobutu, qui, en contexte pourtant de démocratisation de son pays, a légitimé la dictature en inventant et en invoquant la culture.
Finalement, la problématique au cœur de cet article est la suivante : quelle place peut-on reconnaître à la différence au sein de l’universalisme démocratique ? Autrement dit, comment la démocratie en Afrique peut-elle inventer la culture et les institutions sans que cela ne remette en cause les principes démocratiques ? Comment penser la permanence des principes universalistes de la démocratie et les changements adaptatifs nécessaires à son existence en Afrique ?
1. Du droit à la différence culturelle
Un constat factuel s’impose : l’emploi de l’expression « démocratie africaine » ne laisse pas sans réaction, généralement dépréciatif. En effet, cette expression est très souvent qualifiée de « pure exotisme », à l’exemple de ce qu’en pensent certains intellectuels et hommes politiques de premier plan, notamment occidentaux. En substance, ces derniers pensent qu’il ne devrait pas y avoir d’exception africaine en matière de démocratie. Dans le fond, il s’agit, clairement, de faire ressortir que les identités africaines jouent contre la démocratie, qu’elles sont incompatibles avec son processus d’appropriation. Cette postulation a pour conséquence d’affirmer que les sociétés africaines ne sont pas des sociétés dynamiques et donc ouvertes sur le monde. Au nombre des présidents français qui ont soutenu cette position, nous avons Jacques Chirac. Déjà, en 1990, alors Premier Ministre, il déclarait à Abidjan que la démocratie (multipartisme) était « un luxe » et « une erreur politique » pour l’Afrique (Jeune Afrique, n° 1523 du 12 mars 1990). Plus près de nous, Nicolas Sarkozy, dans son « Discours de Dakar » du 26 juillet 2007, affirmait que « Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire » [1].. L’histoire, selon lui, c’est celle de la modernité politique dont l’aboutissement est la démocratie telle que pratiquée en Occident. En un mot, le rapport malheureux des Africains à la démocratie proviendrait de sa tropicalisation, des rapports jugés incestueux entre celle-ci et les coutumes et traditions. Jean-Pierre Chrétien (2008), comme bien d’autres, lui répondra. C’est également le propos portant sur la critique de « l’Etat importé » de Bertrand Badie (1992). De nos jours, le livre polémique de René Dumont, paru en 1962, pourrait s’intituler La démocratie africaine est mal partie. Dans la version originale, L’Afrique noire est mal partie, l’auteur déplorait déjà une « Afrique cliente de l’Europe ». Or, les théories culturalistes, qui substantialisent et hiérarchisent les sociétés, sont aujourd’hui inopérantes lorsqu’il s’agit de qualifier certaines démocraties africaines de « pure exotisme ».
Pour François Roubaud (2003, 14) : « En dépit des vicissitudes politiques [ethiniques] qu’ont eu à subir les Ivoiriens au cours des dernières années, les Abidjanais n’en font pas grief à la démocratie en tant que mode de régulation politique, qu’ils continuent à plébisciter. 93 % d’entre eux restent favorables aux principes démocratiques (63 % « très favorables » et « 30 % « plutôt favorables »). 82 % pensent que malgré les problèmes qui peuvent se présenter, la démocratie est préférable à n’importe qu’elle autre forme de gouvernement ». Pour faire écho à cette citation, Kofi Annan (discours du 5 décembre 2000) parlera de « La soif de l’Afrique pour la démocratie ». Indirectement, cette assertion affirme que les freins à la démocratisation de l’Afrique tiennent moins à la mentalité africaine qu’aux comportements néopatrimoniaux de ses hommes politiques. Le Film de Thierry Michel, Mobutu, roi du Zaïre, réalisé en 1999, rend compte d’une « démocratie africaine » que nous pouvons, à raison, qualifier d’exotique. En effet, après vingt-cinq ans de règne sans partage, le maréchal Mobutu Sesse Seko [2] annonce, le 24 avril 1990, les larmes aux yeux, le tournant du multipartisme [3]. Ce discours s’achève par trois petits mots devenus célèbres : « Comprenez mon émotion ». Larmes de crocodile ou larmes sincères ? On ne saura sans doute jamais. Reste que Mobutu, le Léopard, pressent que le vent de l’histoire est en train de lui échapper. Pour s’en sortir, il invoque son bon droit à pratiquer, dans son pays le Zaïre, aujourd’hui RDC, une démocratie particulière, notamment assise sur « l’authenticité » africaine bantu. Sauf qu’en invoquant cette nouvelle idéologie politique, le Maréchal-Président Mobutu finit par penser qu’il était tout aussi logique de s’exonérer des principes de la démocratie, donc de réclamer une différence de droit. Du coup, dans sa pratique du pouvoir, il récusait toute forme de démocratie fondée sur l’opposition au bénéfice d’une démocratie qu’il appelait lui-même « démocratie de juxtaposition ». Il considérait qu’il n’existait une opposition. Pour lui, les hommes politiques de son pays qui s’en réclamaient étaient plutôt des aigris éjectés du pouvoir et qui avaient perdus les avantages indus liés aux postes qu’ils occupaient. L’application, en régime démocratique, de sa conception dite africaine ou bantu du « chef » rejetait ainsi la contradiction et la contestation, pourtant au fondement de la démocratie. Il pratiquait la gabegie et l’économie de la prédation au sommet de l’Etat (cf. sa somptueuse et indécente demeure de Gbadolité, surnommé la « Versailles de la jungle »). Aux côtés de Mobutu le léopard, dont la chute date de mai 1997, un bon nombre de présidents africains se sont maintenus au pouvoir après les années 90 en remobilisant un imaginaire autour de la symbolique traditionnelle. Les seuls surnoms qu’ils se donnent en sont des exemples. Au demeurant, ces surnoms peuvent faire l’objet d’un véritable traité de « zoologie politique » qui serait à étudier au niveau de la symbolique qu’elle subsume.
En effet, dans la symbolique africaine, lorsqu’un individu s’attribue un patronyme d’animal c’est qu’il recherche et/ou aspire aux mêmes caractéristiques possédées par ce dernier. Pour le cas des espèces d’animaux comme le caïman et le léopard, ils sont le symbole de la puissance, mais aussi de la férocité, de la cruauté et de la félonie. Prenons l’exemple du proverbe apocryphe souvent prononcé par le Président Omar Bongo Ondimba, à savoir : « il ne peut y avoir deux crocodiles dans un même marigot ». Il ne serait pas absurde d’établir un parallèle entre cette évocation du crocodile comme fétiche du pouvoir et la longévité au pouvoir du Président Omar Bongo Ondimba. La férocité du crocodile pour être le seul maitre du marigot pourrait se rapporter politiquement à des pratiques politiques totalitaires. Pour ce qui est du Président de la République du Congo, le journaliste François Soudan affirme ce qui suit : « Denis Sassou Nguesso n’a pas changé […] toujours ces réflexes d’animal politique habitué aux longues traques de félin jouant avec les souris, tour à tour séducteur et rancunier, pattes de velours et griffes dehors. Au sein du marigot congolais, dont il connaît depuis trente ans les moindres recoins où s’agitent, comme dans un vivier, bon nombre d’espèces carnassières et où les règles du jeu ont autant de rapport avec la démocratie que les toiles de Dali avec la réalité, il est le plus fort, et il le sait » (Jeune Afrique,1998, 20).
La plupart des présidents africains autoritaires les plus talentueux (Houphouët-Boigny en Côte d’ivoire, Compaoré au Burkina Faso, Eyadema au Togo, Déby au Tchad, Biya au Cameroun, Bongo au Gabon, Mobutu au Zaïre) ont usé et abusé, après la chute des partis uniques, des coutumes et traditions comme ressource intérieure de légitimation du pouvoir. Cette assertion exprime clairement l’ambivalence politique de la tradition en situation autoritaire. Pour reconsidérer la tradition, Fabien Eboussi Boulaga, dans La crise du Muntu (4e de couverture), propose à l’intellectuel négro-africain de s’inventer lui-même et par lui-même « dans la totalité de ses déterminations et de ses exigences », tant sur le plan socio-culturel des aspérités du quotidien que, de surcroit, sur le plan philosophique. L’émancipation et l’authenticité de la tradition, poursuit Eboussi, passe donc par une nouvelle démarche de libération qui touche à la fois à une épistémologie de l’être, de l’avoir et du faire. Pour résumer, il s’agit pour lui de « vivre par soi et pour soi, par et dans l’articulation de l’avoir et du faire selon un ordre qui exclut la violence et l’arbitraire » (1977, 7).
2. Du droit à la différence institutionnelle ou la rupture avec le mimétisme
Les Conférences nationales, souveraines pour certaines, sont des « inventions africaines ». Cette expression est reprise par Fabien Eboussi Boulaga dans Les Conférences nationales en Afrique noire : une affaire à suivre. Le texte parle précisément « d’invention béninoise » (1993, 14), et soutien que les Conférences nationales sont des actes de fondation et d’initiation d’une nouvelle communauté. Ces conférences ont enclenché la démocratisation des Etats subsahariens. La question qui s’impose ici est celle de savoir en quoi peut-on dire qu’elles sont une invention de la modernité politique africaine ? Ces Conférences sont particulièrement marquées par la relation entre, d’une part, l’Eglise, notamment catholique, et, d’autre part, l’Etat, qui est l’instance de régulation sociale. Cette intrusion du religieux dans le politique se donne précisément à voir comme offre normative de sens du politique, et comme garant de l’ordre moral et antidote de la répression politique arbitraire. Ce recours au religieux, notamment au catholicisme, a eu pour objectif de réguler le politique, de mettre la dynamique ecclésiastique au service de la fermentation des changements politiques dans un contexte de fin d’autoritarisme. Il s’agit là d’une innovation sans pareil qui permet de tenir ensemble les valeurs démocratiques et les valeurs de l’Evangile, notamment sur des questions axiologiques, à l’exemple de la probité morale, de l’impartialité, de la vérité.
Lors de la Conférence nationale souveraine en République Démocratique du Congo (RDC), le Cardinal Joseph Albert Malula, figure de proue de la contestation de la dictature de Mobutu, dira que « La sincérité fait la noblesse et la dignité de l’homme. C’est pourquoi un homme vraiment adulte préfère être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité ». Cette assertion est, sans conteste, un appel lancé aux acteurs politiques, notamment à ceux au pouvoir, de pratiquer la politique autrement que sous sa forme autoritaire. La modernité politique en Afrique noire s’est donc écrite, dès les années 90, par l’investissement du religieux. Celui-ci a exercé des fonctions politiques et sociales, pour reprendre le sens du texte de Peter Berger, à savoir : La religion dans la conscience moderne. Essai d’analyse culturelle (1971, 266). Jean Pierre Venant dira que « le domaine du religieux possède une identité humaine bien définie » (1991, 10) ; laquelle touche, pour reprendre Emile Durkheim (1912), à la théologie sociale et politique. Pour Michel Maslowski, le religieux est un des lieux privilégiés du politique, dès lorsqu’il participe à sa redéfinition à partir des protestations contre tout mouvement que génère une crise (1992, 49). Jean-François Bayart affirmera que « l’Afrique continue d’inventer sa propre modernité en dialoguant avec Dieu » (1993, 12). En fin de compte, il faut retenir ici que selon les personnalités épiscopales et les périodes, au gré des contextes et des conjonctures, l’Eglise catholique a joué lors de ces Conférences nationales, et même par la suite, le rôle de « fonction politique de substitution ».
Ces Conférences nationales ont donné lieu à l’invention d’autres institutions supposées renforcer le contrôle démocratique en Afrique. Par exemple, dans la plupart des pays africains, et au-delà des institutions constantes comme le système judiciaire, exécutif et législatif, il existe, selon les cas, ce qu’on appelle la Commission nationale électorale indépendante (CNI) ou l’Office national des élections (ONE). Le rôle de cette institution est, en substance, l’organisation pratique des élections, la collecte des résultats et la proclamation provisoire des résultats. Le but recherché est celui de contourner l’administration qui est vue, et souvent à raison, comme le bras séculier du Pouvoir. Mais la CNI parvient-elle toujours à contourner le pouvoir ? Dans le cas du Gabon, la question pose problème. En effet, le président de cette institution est nommé par le Président de la République, d’une part, et c’est le Ministre de l’intérieur, et non le président de ladite institution, qui annonce les résultats des élections présidentielles, d’autre part. Quant à la proclamation des résultats définitifs, celle-ci revient à la Cour constitutionnelle dont la Présidente au Gabon est elle aussi nommée par le Président de la République. Cette inféodation par l’Exécutif des institutions inventées confirme malheureusement le propos prêté à feu Omar Bongo, à savoir : « En Afrique on n’organise pas des élections pour les perdre ». Propos sadique qui, semble-t-il, a été avancé suite à la défaite d’Abdou Diouf au second tour du scrutin en 2000 au Sénégal face à son adversaire Abdoulaye Wade. Propos, il est important de le souligner, qui dénient les principes de base d’une élection démocratique, en l’occurrence la transparence, la neutralité, la libre compétition, la libre représentation et la libre participation.
Terminons avec un autre exemple, au Gabon, d’invention institutionnelle censée promouvoir la modernité politique par la différence. Dans le cadre de la préservation et de la promotion de la liberté des médias, fondamentale pour une démocratie, le Gabon, pour apparaitre moderne, a inventé une institution dont le nom est la Haute Autorité de la Communication (HAC). En soi, l’invention de cette institution est un gage de modernité politique. Mais, qu’en est-il dans la réalité ? Pour une autorité censée être indépendante, sa seule composition pose déjà problème. En effet, elle est composée de 9 membres dont 7 sont nommés par le pouvoir et 2 élus par les journalistes. Sa propension à prononcer des sanctions sévères contre les journalistes et médias gabonais privés qui critiquent le pouvoir lui vaut le petit nom de « Hache » ou de « Père fouettard ». Suite à une énième convocation/suspension par la HAC des médias privés au Gabon, en l’occurrence le journal en ligne Gabon Media Time (GMT), Reporter Sans Frontières (RSF) publie, le 06 Aout 2019, le communiqué suivant : « Reporters sans frontières (RSF) condamne sans réserve la suspension de l’un des sites d’information les plus fréquentés du pays par la Haute autorité de la communication (HAC). Cette nouvelle sanction arbitraire jette encore un peu plus le discrédit sur un organe de régulation qui s’obstine dans sa politique répressive des médias ».
Plus loin, dans le même communiqué, RSF poursuit : « Une fois de plus cet organe de régulation apparaît comme une machine à sanctions, piochant dans l’arsenal législatif vague, imprécis et liberticide des textes qui encadrent l’exercice du journalisme au Gabon pour servir les intérêts du pouvoir et empêcher toutes critiques légitimes sur des sujets d’intérêt général, déplore Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de RSF. Cette politique de sanctions systématiques génère de l’autocensure, met en difficulté économique de nombreux médias et contribue à détériorer l’image du pays. Si les autorités gabonaises sont encore attachées à la liberté de la presse, elles n’auront d’autres choix que de réformer en profondeur les textes qui l’encadrent et l’organe censé en assurer la défense ». De la liberté de la presse, donc de la démocratie, qu’elle est censée promouvoir, la HAC apparaît, dans les faits, comme le « bourreau des médias privés gabonais marqués de l’opposition ». Dans le classement mondial fait par RSF en 2019 des pays promouvant la liberté de la presse, le Gabon occupe la 115e position sur 180 pays. La HAC, censée caractériser l’invention de la modernité politique gabonaise en matière de protection et liberté de la presse, s’est finalement transformée en arme répressive contre les médias de l’opposition et autres médias qui la soutiennent. Au Gabon, comme c’est le cas dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne, l’Etat conserve encore le monopole de la diffusion de l’information politique, même lorsque, comme c’est le cas à travers la HAC, il a accordé des licences d’exploitation aux médias privés. Si l’invention de ces institutions traduit, en n’en point douter, la modernité politique africaine, reste que, dans la plupart des cas, cette invention n’est que formelle et n’est donc pas un gage de l’existence effective des régimes démocratiques africains. La raison principale de la non effectivité de ces institutions inventées est connue : la mise en cause de l’éthique de responsabilité des acteurs politiques aux affaires dont le degré de résistance à réellement libéraliser la vie démocratique est avéré (clientélisme, népotisme, État comme moyen d’accès aux ressources, etc.). Depuis 1990, l’invention institutionnelle, très forte et créative en Afrique, contraste avec la crédibilité que les acteurs politiques accordent à ces mêmes institutions démocratiques. Or, le pari de l’invention institutionnelle repose sur la capacité des acteurs à être conscients des enjeux de développement. Dans Les Conférences nationales en Afrique noire : une affaire à suivre, Fabien Eboussi Boulaga parle de l’« Etat fétichiste » en Afrique. Pour lui, il s’agit d’un Etat qui fonctionne « sans son peuple, bien plus encore contre celui-ci, qui devient son opposé, voire son ennemi » (op. cit., p. 98). « L’Etat fétiche » (idem, p. 102) est pour lui une rechute dans l’Etat de nature qui est « irréformable » (ibidem, p. 123).
Conclusion
La problématique principale qui a servi de fil conducteur à la progression de cet article était la suivante : comment la démocratie en Afrique peut-elle inventer la culture et les institutions sans que cela ne remette en cause les principes démocratiques ? Autrement dit, comment penser la permanence des principes universalistes de la démocratie et les changements adaptatifs nécessaires, dans la pratique, à son existence en Afrique ? Comment l’Afrique peut-elle inventer la modernité politique si ce n’est en promouvant un droit à la différence ? Il ne s’agissait pas ici de revendiquer un droit à la différence démocratique pour violer ou pour s’affranchir des principes de la démocratie, de bonnes gouvernances et de développement, ce qu’ont malheureusement fait certains dictateurs africains comme Mobutu dans l’ex-Zaïre. Nous avons noté que ce n’est ni la culture en elle-même et encore moins les institutions positives inventées qui sont en cause. Ces institutions ne sont pas en elles-mêmes des marqueurs d’appréciation ou de dépréciation du rapport des Africains à la démocratie. Elles ne sont des marqueurs qu’en appréciant plutôt l’usage qu’en font les gouvernants, pour la modernité politique ou pour des ambitions personnelles.
Retenons simplement ici que les institutions sont ou doivent être le produit des besoins d’une société donnée. Elles varient forcément d’une société à l’autre en fonction de l’histoire, de la géographie, de la culture, de l’état et du degré de développement de la société concernée. Mais il reste que dans toutes démocraties, il existe des institutions constantes et indépendantes : le système exécutif, judiciaire et législatif. Pour Eboussi Boulaga (1993, 126), la sortie de crise des Etats africains passe par la création de « crédit » comme « force instauratrice immanente de toute constitution politique ». Ce n’est qu’à ce prix qu’il est possible de fonder « une nouvelle communauté constituée en forme de parole et de liberté (1993, p.137).
Bibliographie
Akindes Francis, Les mirages de la démocratie en Afrique subsaharienne francophone, CODESRIA, Dakar, 1995.
Cahen Michel, Ethnicité politique : pour une lecture réaliste de l’identité, Paris, L’Harmattan, 1994.
Badie Bertrand, L’Etat importé. Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique, Paris, Fayard, 1992.
Bayart Jean-François, L’Etat en Afrique : la politique du ventre, Paris, Fayard, 1989.
Bayart Jean-François, « Les sociétés africaines face à l’État », Pouvoirs, nº 25, avril 1983.
Bayart Jean-François, La démocratie à l’épreuve de la tradition en Afrique subsaharienne, Paris, Le Seuil, 2009.
Bayart Jean-François (dir.), Religion et modernité politique en Afrique noire. Dieu pour tous et chacun pour soi, Paris, Karthala, 1993.
Chrétien Jean-Pierre (dir.), L’Afrique de Sarkozy. Un déni d’histoire, Paris, Karthala, 2008.
Durkheim Emile, Le suicide, Paris, Alcan, 1897.
Durkheim Emile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 1912.
Guyer Jane, « La tradition de l’invention en Afrique équatoriale », in Politique africaine, nº 79, octobre 2000.
Eboussi boulaga Fabien, La Crise du Muntu. Authenticité africaine et philosophie, Présence africaine, 1977.
Eboussi Boulaga Fabien, Les conférences nationales en Afrique noire. Une affaire à suivre, Karthala, Paris, 1993.
Lévy-Bruhl, La mentalité primitive, Paris, Alcan, 1922.
Malula R., Joseph-Albert, Liberté et indocilité d’un cardinal africain, Paris, Karthala, 2014.
Otayek René, L’Afrique : les identités contre la démocratie, Editeur scientifique, Cahiers des sciences humaines Nouvelle, série numéro 10, Paris, Éditions de l’Aube, 1999.
Roubaud, Francois, « La crise d’en-bas à Abidjan : Ethnicité, gouvernance et démocratie », DIAL, UR CIPRÉ ; Document de travail DIAL / Unité de Recherche CIPRÉ Octobre 2003.
Touraine Alain, La voix et le regard, Paris, Seuil, 1978.
Venant Jean-Pierre, « Quelqu’un frappe à la porte », in Le religieux dans le politique, Paris, Seuil, 1991.
Verdier Yvonne, Façons de dire, Façons de faire. La laveuse, la couturière, la cuisinière, Paris, Gallimard, 1979.
Pour citer cet article : Christ-Olivier Mpaga, « Du droit à la différence, à la différence de droit. Principe et réalisations de la démocratie en Afrique subsaharienne », Revue Oudjat en Ligne, numéro 3, volume 1, janvier 2020. Actes du Colloque international de Libreville : L’Afrique au XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et doctrines scientifiques, Haut de Gué-gué, du 26 au 28 juin 2019. ISBN : 978-2-912603-94-4/EAN : 9782912603944.
[1] Lire à ce sujet la critique apportée par Jean-Pierre Chrétien (dir.), L’Afrique de Sarkozy. Un déni d’histoire, Karthala, 2008
[2] De Joseph Désiré Mobutu, il devient Mobutu Sesse Seko Kuku Ngenbdu waZabanga : le guerrier tout-puissant et victorieux à qui rien ne résiste. Sesse Seko signifie aussi l’Eternel, celui qui dure.
[3] La conférence nationale qui s’ouvre commence le 7 août 1991 et s’achève en août 1992 et place l’opposant historique Etienne Tshisekedi au poste de Premier Ministre de la transition. Il faudra tout de même attendre 1997, soit près de sept ans après le discours du 24 avril 1990, pour que le Léopard finisse par quitter le pouvoir sous les coups de boutoir de la guerre et de la rébellion menée par un certain Laurent-Désiré Kabila.
ACCUEIL » PUBLICATIONS » ANCIENS NUMEROS » L’Afrique dans le XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et doctrines scientifiques, numéro 3, volume 1, janvier 2020 » Articles de ce numéro
AN = Du droit à la différence, à la différence de droit.Christ-Olivier Mpaga,
Le droit à la différence doit être entendu ici comme la volonté des Etats africains de faire cohabiter les savoirs et pratiques endogènes avec la démocratie. C’est le droit comme prérogative permettant aux Etats de ce continent de se démocratiser en exprimant leur particularité ou encore leur spécificité. Mais, dans ce texte, nous entendrons aussi que ce droit à la différence ne peut pas être revendiqué s’il ne fait pas sens à partir d’une référence fondatrice, en l’occurrence celles des principes démocratiques. Quant aux principes démocratiques, nous les tirerons de la déclaration Universelle sur la démocratie. Celle-ci déclare en effet que la démocratie est universellement reconnue comme un idéal et un but, qu’elle est fondée sur des valeurs communes partagées par les peuples du monde malgré leurs différences culturelle, politique et économique. Dans sa pratique, et donc dans ce qui la distingue des autres systèmes de gouvernement, la démocratie s’entend comme le droit qu’a le peuple de participer à la gestion des affaires publiques. Par là, il faut comprendre que la légitimité et la légitimation du gouvernement et des pratiques de gouvernement émanent du peuple, comme le stipule « La Déclaration de Vienne sur les droits de l’homme » (1993). Enfin, la culture s’entendra ici « comme réalité de fait de conscience ou comme produit des effets de la réalité », au sens que lui donne Michel Cahen (1994, 64). Il s’agit là d’une définition de la culture comprise comme le fait pour une communauté humaine de prendre en charge collectivement son destin, et ce à partir de son historicité propre. Dans la culture, selon Yvonne Verdier (1979, 81-82), « les termes mêmes de tradition, de coutume servent de référence et assoient ce qui se fait comme manifestation propre à la collectivité et sanctionnée par elle […] Cependant l’exigence normative de « faire la coutume » n’oblitère jamais l’événement. Tout au contraire, celui-ci nourrit la coutume ». Plus explicitement, la culture renverra ici aux traditions et coutumes qui en sont l’expression. La particularité de l’engagement démocratique en Afrique subsaharienne, par la cohabitation du politique et du culturel (tradition/coutume), d’une part, et par l’invention d’institutions positives supposés renforcer le contrôle démocratique, d’autre part, laisserait sous-entendre que les Etats de cette partie du continent pratiquent une rationalité démocratique contextualisées. Autrement dit, une forme de production proprement africaine de la modernité politique. Mais, ce sous-entendu mérite d’être évalué. Il s’agit de voir si la démocratie contextualisée par les Etats africains peut être considérée comme une invention ou ré-invention de la modernité politique. Une première question s’impose alors : que signifie cette intervention du culturel dans l’espace démocratique africain, entendu que les Indépendances des Etats d’Afrique subsaharienne (francophone) se sont faites sous le modèle politique de l’Etat-nation laïc ? Ce modèle prône l’unité et l’indivisibilité de la nation par la seule reconnaissance de la citoyenneté, exit les affirmations identitaires dans l’espace publique. Deuxième question : quelle réalité de faits conduit les Etats africains à se démocratiser en inventant des institutions, à l’exemple, entre autres, des Commissions Nationales Electorales présentes dans la plupart de ces Etats ? L’Afrique inventerait ou réinventerait la modernité politique à la seule condition qu’elle prenne la mesure de ce en quoi consiste la notion d’invention, appliquée aussi bien à la culture qu’à ses institutions positives propres. Pour Jean-François Bayart (1983, 23-39), l’invention de la culture se rapporte à sa « dé-tropicalisation », c’est-à-dire en une remise en cause de la « mentalité primitive » ou « prélogique » (Lévy-Bruhl, 1922), par opposition à une « mentalité logique ». Rapportée à la notion d’invention de la modernité politique, cette assertion sous-entend que la culture (traditions et coutumes) ne doit pas nourrir l’évènement présent en Afrique, à savoir sa démocratisation. Cette invention suppose plutôt que c’est la démocratisation des Etats de ce continent qui doit nourrir la culture. C’est la raison pour laquelle Jean-François Bayart affirme (2009, 28) qu’« En Afrique comme ailleurs, il y a eu invention de la modernité par « invention de la tradition ». Bayart propose donc de commencer par inventer la culture. Fabien Eboussi Boulaga (1977, 145) nous donne une définition dans ce sens. Pour lui, la culture est « un être-ensemble et un avoir-en-commun qui appellent à une destinée commune par un agir-ensemble ». Cet agir-ensemble, nous dit Eboussi dans La Crise du Muntu (4e de couverture), commande d’« instaurer en Afrique Noire un discours philosophique, dépassant les obstacles qui oblitèrent encore son avènement ». Ce qui veut dire qu’inventer la modernité politique des Etats africains à partir de la culture, c’est regarder si ces acteurs politiques, en pratique, trouvent du sens dans la cohabitation des savoirs et pratiques endogènes avec la démocratie. La logique du sens de cette cohabitation vaut également lorsqu’il s’agit des institutions classiques de la démocratie avec les institutions positives africaines inventées. Cependant, un constat général fait apparaitre que les formes de production endogène de la démocratie en Afrique ne sont que des tentatives de pacification de la crise de confiance permanente entre les gouvernants et les gouvernés. Ces tentatives n’ont malheureusement pas toujours atteint le but escompté. A tout le moins, elles n’ont pas pacifié, dans la longue durée, l’espace politique africain. La principale raison de cet échec est connue : c’est la subordination du principe démocratique aux usages intéressés de la tradition et des institutions. Ainsi, du bon droit à revendiquer un droit à la différence, on en vient malheureusement à revendiquer une différence de droit, donc à nier le principe même de l’universalisme démocratique. En Afrique, l’invention de la tradition et des institutions peuvent déboucher, en fonction du jeu des acteurs, sur une modernité politique ou, au contraire, sur une dictature, à l’exemple, entre autres chefs d’Etat, de Mobutu, qui, en contexte pourtant de démocratisation de son pays, a légitimé la dictature en inventant et en invoquant la culture. Finalement, la problématique au cœur de cet article est la suivante : quelle place peut-on reconnaître à la différence au sein de l’universalisme démocratique ? Autrement dit, comment la démocratie en Afrique peut-elle inventer la culture et les institutions sans que cela ne remette en cause les principes démocratiques ? Comment penser la permanence des principes universalistes de la démocratie et les changements adaptatifs nécessaires à son existence en Afrique ? 1. Du droit à la différence culturelleUn constat factuel s’impose : l’emploi de l’expression « démocratie africaine » ne laisse pas sans réaction, généralement dépréciatif. En effet, cette expression est très souvent qualifiée de « pure exotisme », à l’exemple de ce qu’en pensent certains intellectuels et hommes politiques de premier plan, notamment occidentaux. En substance, ces derniers pensent qu’il ne devrait pas y avoir d’exception africaine en matière de démocratie. Dans le fond, il s’agit, clairement, de faire ressortir que les identités africaines jouent contre la démocratie, qu’elles sont incompatibles avec son processus d’appropriation. Cette postulation a pour conséquence d’affirmer que les sociétés africaines ne sont pas des sociétés dynamiques et donc ouvertes sur le monde. Au nombre des présidents français qui ont soutenu cette position, nous avons Jacques Chirac. Déjà, en 1990, alors Premier Ministre, il déclarait à Abidjan que la démocratie (multipartisme) était « un luxe » et « une erreur politique » pour l’Afrique (Jeune Afrique, n° 1523 du 12 mars 1990). Plus près de nous, Nicolas Sarkozy, dans son « Discours de Dakar » du 26 juillet 2007, affirmait que « Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire » [1].. L’histoire, selon lui, c’est celle de la modernité politique dont l’aboutissement est la démocratie telle que pratiquée en Occident. En un mot, le rapport malheureux des Africains à la démocratie proviendrait de sa tropicalisation, des rapports jugés incestueux entre celle-ci et les coutumes et traditions. Jean-Pierre Chrétien (2008), comme bien d’autres, lui répondra. C’est également le propos portant sur la critique de « l’Etat importé » de Bertrand Badie (1992). De nos jours, le livre polémique de René Dumont, paru en 1962, pourrait s’intituler La démocratie africaine est mal partie. Dans la version originale, L’Afrique noire est mal partie, l’auteur déplorait déjà une « Afrique cliente de l’Europe ». Or, les théories culturalistes, qui substantialisent et hiérarchisent les sociétés, sont aujourd’hui inopérantes lorsqu’il s’agit de qualifier certaines démocraties africaines de « pure exotisme ». Pour François Roubaud (2003, 14) : « En dépit des vicissitudes politiques [ethiniques] qu’ont eu à subir les Ivoiriens au cours des dernières années, les Abidjanais n’en font pas grief à la démocratie en tant que mode de régulation politique, qu’ils continuent à plébisciter. 93 % d’entre eux restent favorables aux principes démocratiques (63 % « très favorables » et « 30 % « plutôt favorables »). 82 % pensent que malgré les problèmes qui peuvent se présenter, la démocratie est préférable à n’importe qu’elle autre forme de gouvernement ». Pour faire écho à cette citation, Kofi Annan (discours du 5 décembre 2000) parlera de « La soif de l’Afrique pour la démocratie ». Indirectement, cette assertion affirme que les freins à la démocratisation de l’Afrique tiennent moins à la mentalité africaine qu’aux comportements néopatrimoniaux de ses hommes politiques. Le Film de Thierry Michel, Mobutu, roi du Zaïre, réalisé en 1999, rend compte d’une « démocratie africaine » que nous pouvons, à raison, qualifier d’exotique. En effet, après vingt-cinq ans de règne sans partage, le maréchal Mobutu Sesse Seko [2] annonce, le 24 avril 1990, les larmes aux yeux, le tournant du multipartisme [3]. Ce discours s’achève par trois petits mots devenus célèbres : « Comprenez mon émotion ». Larmes de crocodile ou larmes sincères ? On ne saura sans doute jamais. Reste que Mobutu, le Léopard, pressent que le vent de l’histoire est en train de lui échapper. Pour s’en sortir, il invoque son bon droit à pratiquer, dans son pays le Zaïre, aujourd’hui RDC, une démocratie particulière, notamment assise sur « l’authenticité » africaine bantu. Sauf qu’en invoquant cette nouvelle idéologie politique, le Maréchal-Président Mobutu finit par penser qu’il était tout aussi logique de s’exonérer des principes de la démocratie, donc de réclamer une différence de droit. Du coup, dans sa pratique du pouvoir, il récusait toute forme de démocratie fondée sur l’opposition au bénéfice d’une démocratie qu’il appelait lui-même « démocratie de juxtaposition ». Il considérait qu’il n’existait une opposition. Pour lui, les hommes politiques de son pays qui s’en réclamaient étaient plutôt des aigris éjectés du pouvoir et qui avaient perdus les avantages indus liés aux postes qu’ils occupaient. L’application, en régime démocratique, de sa conception dite africaine ou bantu du « chef » rejetait ainsi la contradiction et la contestation, pourtant au fondement de la démocratie. Il pratiquait la gabegie et l’économie de la prédation au sommet de l’Etat (cf. sa somptueuse et indécente demeure de Gbadolité, surnommé la « Versailles de la jungle »). Aux côtés de Mobutu le léopard, dont la chute date de mai 1997, un bon nombre de présidents africains se sont maintenus au pouvoir après les années 90 en remobilisant un imaginaire autour de la symbolique traditionnelle. Les seuls surnoms qu’ils se donnent en sont des exemples. Au demeurant, ces surnoms peuvent faire l’objet d’un véritable traité de « zoologie politique » qui serait à étudier au niveau de la symbolique qu’elle subsume. En effet, dans la symbolique africaine, lorsqu’un individu s’attribue un patronyme d’animal c’est qu’il recherche et/ou aspire aux mêmes caractéristiques possédées par ce dernier. Pour le cas des espèces d’animaux comme le caïman et le léopard, ils sont le symbole de la puissance, mais aussi de la férocité, de la cruauté et de la félonie. Prenons l’exemple du proverbe apocryphe souvent prononcé par le Président Omar Bongo Ondimba, à savoir : « il ne peut y avoir deux crocodiles dans un même marigot ». Il ne serait pas absurde d’établir un parallèle entre cette évocation du crocodile comme fétiche du pouvoir et la longévité au pouvoir du Président Omar Bongo Ondimba. La férocité du crocodile pour être le seul maitre du marigot pourrait se rapporter politiquement à des pratiques politiques totalitaires. Pour ce qui est du Président de la République du Congo, le journaliste François Soudan affirme ce qui suit : « Denis Sassou Nguesso n’a pas changé […] toujours ces réflexes d’animal politique habitué aux longues traques de félin jouant avec les souris, tour à tour séducteur et rancunier, pattes de velours et griffes dehors. Au sein du marigot congolais, dont il connaît depuis trente ans les moindres recoins où s’agitent, comme dans un vivier, bon nombre d’espèces carnassières et où les règles du jeu ont autant de rapport avec la démocratie que les toiles de Dali avec la réalité, il est le plus fort, et il le sait » (Jeune Afrique,1998, 20). La plupart des présidents africains autoritaires les plus talentueux (Houphouët-Boigny en Côte d’ivoire, Compaoré au Burkina Faso, Eyadema au Togo, Déby au Tchad, Biya au Cameroun, Bongo au Gabon, Mobutu au Zaïre) ont usé et abusé, après la chute des partis uniques, des coutumes et traditions comme ressource intérieure de légitimation du pouvoir. Cette assertion exprime clairement l’ambivalence politique de la tradition en situation autoritaire. Pour reconsidérer la tradition, Fabien Eboussi Boulaga, dans La crise du Muntu (4e de couverture), propose à l’intellectuel négro-africain de s’inventer lui-même et par lui-même « dans la totalité de ses déterminations et de ses exigences », tant sur le plan socio-culturel des aspérités du quotidien que, de surcroit, sur le plan philosophique. L’émancipation et l’authenticité de la tradition, poursuit Eboussi, passe donc par une nouvelle démarche de libération qui touche à la fois à une épistémologie de l’être, de l’avoir et du faire. Pour résumer, il s’agit pour lui de « vivre par soi et pour soi, par et dans l’articulation de l’avoir et du faire selon un ordre qui exclut la violence et l’arbitraire » (1977, 7). 2. Du droit à la différence institutionnelle ou la rupture avec le mimétismeLes Conférences nationales, souveraines pour certaines, sont des « inventions africaines ». Cette expression est reprise par Fabien Eboussi Boulaga dans Les Conférences nationales en Afrique noire : une affaire à suivre. Le texte parle précisément « d’invention béninoise » (1993, 14), et soutien que les Conférences nationales sont des actes de fondation et d’initiation d’une nouvelle communauté. Ces conférences ont enclenché la démocratisation des Etats subsahariens. La question qui s’impose ici est celle de savoir en quoi peut-on dire qu’elles sont une invention de la modernité politique africaine ? Ces Conférences sont particulièrement marquées par la relation entre, d’une part, l’Eglise, notamment catholique, et, d’autre part, l’Etat, qui est l’instance de régulation sociale. Cette intrusion du religieux dans le politique se donne précisément à voir comme offre normative de sens du politique, et comme garant de l’ordre moral et antidote de la répression politique arbitraire. Ce recours au religieux, notamment au catholicisme, a eu pour objectif de réguler le politique, de mettre la dynamique ecclésiastique au service de la fermentation des changements politiques dans un contexte de fin d’autoritarisme. Il s’agit là d’une innovation sans pareil qui permet de tenir ensemble les valeurs démocratiques et les valeurs de l’Evangile, notamment sur des questions axiologiques, à l’exemple de la probité morale, de l’impartialité, de la vérité. Lors de la Conférence nationale souveraine en République Démocratique du Congo (RDC), le Cardinal Joseph Albert Malula, figure de proue de la contestation de la dictature de Mobutu, dira que « La sincérité fait la noblesse et la dignité de l’homme. C’est pourquoi un homme vraiment adulte préfère être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité ». Cette assertion est, sans conteste, un appel lancé aux acteurs politiques, notamment à ceux au pouvoir, de pratiquer la politique autrement que sous sa forme autoritaire. La modernité politique en Afrique noire s’est donc écrite, dès les années 90, par l’investissement du religieux. Celui-ci a exercé des fonctions politiques et sociales, pour reprendre le sens du texte de Peter Berger, à savoir : La religion dans la conscience moderne. Essai d’analyse culturelle (1971, 266). Jean Pierre Venant dira que « le domaine du religieux possède une identité humaine bien définie » (1991, 10) ; laquelle touche, pour reprendre Emile Durkheim (1912), à la théologie sociale et politique. Pour Michel Maslowski, le religieux est un des lieux privilégiés du politique, dès lorsqu’il participe à sa redéfinition à partir des protestations contre tout mouvement que génère une crise (1992, 49). Jean-François Bayart affirmera que « l’Afrique continue d’inventer sa propre modernité en dialoguant avec Dieu » (1993, 12). En fin de compte, il faut retenir ici que selon les personnalités épiscopales et les périodes, au gré des contextes et des conjonctures, l’Eglise catholique a joué lors de ces Conférences nationales, et même par la suite, le rôle de « fonction politique de substitution ». Ces Conférences nationales ont donné lieu à l’invention d’autres institutions supposées renforcer le contrôle démocratique en Afrique. Par exemple, dans la plupart des pays africains, et au-delà des institutions constantes comme le système judiciaire, exécutif et législatif, il existe, selon les cas, ce qu’on appelle la Commission nationale électorale indépendante (CNI) ou l’Office national des élections (ONE). Le rôle de cette institution est, en substance, l’organisation pratique des élections, la collecte des résultats et la proclamation provisoire des résultats. Le but recherché est celui de contourner l’administration qui est vue, et souvent à raison, comme le bras séculier du Pouvoir. Mais la CNI parvient-elle toujours à contourner le pouvoir ? Dans le cas du Gabon, la question pose problème. En effet, le président de cette institution est nommé par le Président de la République, d’une part, et c’est le Ministre de l’intérieur, et non le président de ladite institution, qui annonce les résultats des élections présidentielles, d’autre part. Quant à la proclamation des résultats définitifs, celle-ci revient à la Cour constitutionnelle dont la Présidente au Gabon est elle aussi nommée par le Président de la République. Cette inféodation par l’Exécutif des institutions inventées confirme malheureusement le propos prêté à feu Omar Bongo, à savoir : « En Afrique on n’organise pas des élections pour les perdre ». Propos sadique qui, semble-t-il, a été avancé suite à la défaite d’Abdou Diouf au second tour du scrutin en 2000 au Sénégal face à son adversaire Abdoulaye Wade. Propos, il est important de le souligner, qui dénient les principes de base d’une élection démocratique, en l’occurrence la transparence, la neutralité, la libre compétition, la libre représentation et la libre participation. Terminons avec un autre exemple, au Gabon, d’invention institutionnelle censée promouvoir la modernité politique par la différence. Dans le cadre de la préservation et de la promotion de la liberté des médias, fondamentale pour une démocratie, le Gabon, pour apparaitre moderne, a inventé une institution dont le nom est la Haute Autorité de la Communication (HAC). En soi, l’invention de cette institution est un gage de modernité politique. Mais, qu’en est-il dans la réalité ? Pour une autorité censée être indépendante, sa seule composition pose déjà problème. En effet, elle est composée de 9 membres dont 7 sont nommés par le pouvoir et 2 élus par les journalistes. Sa propension à prononcer des sanctions sévères contre les journalistes et médias gabonais privés qui critiquent le pouvoir lui vaut le petit nom de « Hache » ou de « Père fouettard ». Suite à une énième convocation/suspension par la HAC des médias privés au Gabon, en l’occurrence le journal en ligne Gabon Media Time (GMT), Reporter Sans Frontières (RSF) publie, le 06 Aout 2019, le communiqué suivant : « Reporters sans frontières (RSF) condamne sans réserve la suspension de l’un des sites d’information les plus fréquentés du pays par la Haute autorité de la communication (HAC). Cette nouvelle sanction arbitraire jette encore un peu plus le discrédit sur un organe de régulation qui s’obstine dans sa politique répressive des médias ». Plus loin, dans le même communiqué, RSF poursuit : « Une fois de plus cet organe de régulation apparaît comme une machine à sanctions, piochant dans l’arsenal législatif vague, imprécis et liberticide des textes qui encadrent l’exercice du journalisme au Gabon pour servir les intérêts du pouvoir et empêcher toutes critiques légitimes sur des sujets d’intérêt général, déplore Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de RSF. Cette politique de sanctions systématiques génère de l’autocensure, met en difficulté économique de nombreux médias et contribue à détériorer l’image du pays. Si les autorités gabonaises sont encore attachées à la liberté de la presse, elles n’auront d’autres choix que de réformer en profondeur les textes qui l’encadrent et l’organe censé en assurer la défense ». De la liberté de la presse, donc de la démocratie, qu’elle est censée promouvoir, la HAC apparaît, dans les faits, comme le « bourreau des médias privés gabonais marqués de l’opposition ». Dans le classement mondial fait par RSF en 2019 des pays promouvant la liberté de la presse, le Gabon occupe la 115e position sur 180 pays. La HAC, censée caractériser l’invention de la modernité politique gabonaise en matière de protection et liberté de la presse, s’est finalement transformée en arme répressive contre les médias de l’opposition et autres médias qui la soutiennent. Au Gabon, comme c’est le cas dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne, l’Etat conserve encore le monopole de la diffusion de l’information politique, même lorsque, comme c’est le cas à travers la HAC, il a accordé des licences d’exploitation aux médias privés. Si l’invention de ces institutions traduit, en n’en point douter, la modernité politique africaine, reste que, dans la plupart des cas, cette invention n’est que formelle et n’est donc pas un gage de l’existence effective des régimes démocratiques africains. La raison principale de la non effectivité de ces institutions inventées est connue : la mise en cause de l’éthique de responsabilité des acteurs politiques aux affaires dont le degré de résistance à réellement libéraliser la vie démocratique est avéré (clientélisme, népotisme, État comme moyen d’accès aux ressources, etc.). Depuis 1990, l’invention institutionnelle, très forte et créative en Afrique, contraste avec la crédibilité que les acteurs politiques accordent à ces mêmes institutions démocratiques. Or, le pari de l’invention institutionnelle repose sur la capacité des acteurs à être conscients des enjeux de développement. Dans Les Conférences nationales en Afrique noire : une affaire à suivre, Fabien Eboussi Boulaga parle de l’« Etat fétichiste » en Afrique. Pour lui, il s’agit d’un Etat qui fonctionne « sans son peuple, bien plus encore contre celui-ci, qui devient son opposé, voire son ennemi » (op. cit., p. 98). « L’Etat fétiche » (idem, p. 102) est pour lui une rechute dans l’Etat de nature qui est « irréformable » (ibidem, p. 123). ConclusionLa problématique principale qui a servi de fil conducteur à la progression de cet article était la suivante : comment la démocratie en Afrique peut-elle inventer la culture et les institutions sans que cela ne remette en cause les principes démocratiques ? Autrement dit, comment penser la permanence des principes universalistes de la démocratie et les changements adaptatifs nécessaires, dans la pratique, à son existence en Afrique ? Comment l’Afrique peut-elle inventer la modernité politique si ce n’est en promouvant un droit à la différence ? Il ne s’agissait pas ici de revendiquer un droit à la différence démocratique pour violer ou pour s’affranchir des principes de la démocratie, de bonnes gouvernances et de développement, ce qu’ont malheureusement fait certains dictateurs africains comme Mobutu dans l’ex-Zaïre. Nous avons noté que ce n’est ni la culture en elle-même et encore moins les institutions positives inventées qui sont en cause. Ces institutions ne sont pas en elles-mêmes des marqueurs d’appréciation ou de dépréciation du rapport des Africains à la démocratie. Elles ne sont des marqueurs qu’en appréciant plutôt l’usage qu’en font les gouvernants, pour la modernité politique ou pour des ambitions personnelles. Retenons simplement ici que les institutions sont ou doivent être le produit des besoins d’une société donnée. Elles varient forcément d’une société à l’autre en fonction de l’histoire, de la géographie, de la culture, de l’état et du degré de développement de la société concernée. Mais il reste que dans toutes démocraties, il existe des institutions constantes et indépendantes : le système exécutif, judiciaire et législatif. Pour Eboussi Boulaga (1993, 126), la sortie de crise des Etats africains passe par la création de « crédit » comme « force instauratrice immanente de toute constitution politique ». Ce n’est qu’à ce prix qu’il est possible de fonder « une nouvelle communauté constituée en forme de parole et de liberté (1993, p.137). BibliographieAkindes Francis, Les mirages de la démocratie en Afrique subsaharienne francophone, CODESRIA, Dakar, 1995. Pour citer cet article : Christ-Olivier Mpaga, « Du droit à la différence, à la différence de droit. Principe et réalisations de la démocratie en Afrique subsaharienne », Revue Oudjat en Ligne, numéro 3, volume 1, janvier 2020. Actes du Colloque international de Libreville : L’Afrique au XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et doctrines scientifiques, Haut de Gué-gué, du 26 au 28 juin 2019. ISBN : 978-2-912603-94-4/EAN : 9782912603944. |
|
[1] Lire à ce sujet la critique apportée par Jean-Pierre Chrétien (dir.), L’Afrique de Sarkozy. Un déni d’histoire, Karthala, 2008 [2] De Joseph Désiré Mobutu, il devient Mobutu Sesse Seko Kuku Ngenbdu waZabanga : le guerrier tout-puissant et victorieux à qui rien ne résiste. Sesse Seko signifie aussi l’Eternel, celui qui dure. [3] La conférence nationale qui s’ouvre commence le 7 août 1991 et s’achève en août 1992 et place l’opposant historique Etienne Tshisekedi au poste de Premier Ministre de la transition. Il faudra tout de même attendre 1997, soit près de sept ans après le discours du 24 avril 1990, pour que le Léopard finisse par quitter le pouvoir sous les coups de boutoir de la guerre et de la rébellion menée par un certain Laurent-Désiré Kabila. |

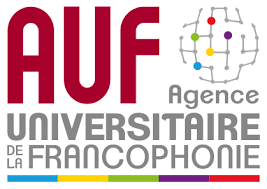
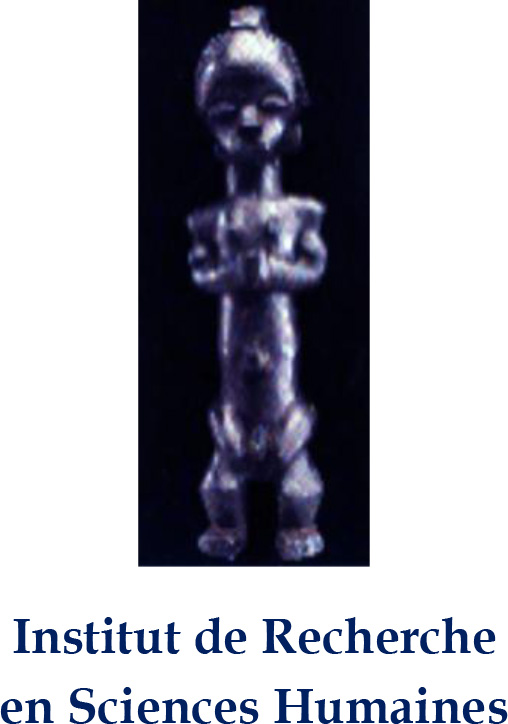 la penser ensemble...
la penser ensemble...