++Rapport Général du Colloque « Les post- et les anthropologies en Afrique ».
Le colloque national « Les post- et les anthropologies en Afrique », organisé par les Editions Oudjat en Ligne à l’Université Omar Bongo les 14 et 15 juin 2018, avec les soutiens institutionnels de l’Université Omar Bongo, de l’Institut de Recherche en Sciences Humaines et de l’Agence Universitaire de la Francophonie, a enregistré plus d’une vingtaine de communications présentées, pour certaines, sous forme de conférence inaugurale et de conférences plénières, et pour d’autres, sous formes de communications intégrées à quatre panels thématiques. Ceux-ci se présentaient comme suit :
Panel 1 : Epistémologies et empirismes critiques ;
Panel 2 : Circulations et reconstructions des savoirs ;
Panel 3 : Altérités africaines ;
Panel 4 : Sens et significations : représentations et questionnements.
Quatre conférences dont la conférence inaugurale de Jacques Fontanille (Université de Limoges), les plénières de Camille Roger Abolou (Université de Bouaké), Joseph Tonda (Université Omar Bongo), et de Charles Romain Mbele (Ecole Normale Supérieure de l’Université de Yaoundé 1), ont permis de démêler les difficultés épistémologiques et les problématiques méthodologiques auxquelles sont confrontées les sciences sociales en Afrique subsaharienne.
Au cours des différentes conférences, un accent particulier a été porté sur l’anthropologie telle que pratiquée et enseignée dans les universités africaines.
En effet, l’anthropologie contemporaine est prise dans un mouvement de réexamen des conséquences théoriques et épistémologiques des colonialismes, ainsi que dans une remise en question et une relativisation des présupposés du naturalisme moderne, qui radicalement a transformé le rapport à l’autre. Les avancées de l’éthologie sémiotique, entre autres domaines de recherche, conduisent à ces interrogations.
Selon Jacques Fontanille, le mouvement brésilien dit « anthropophage », mené par Viveiros de Castro, né au début du XXe siècle en réaction contre la soumission des élites brésiliennes aux canons esthétiques, aux normes culturelles et aux points de vue scientifiques forgés en Europe, instruit sur le rapport des sciences humaines et sociales à l’altérité anthropologique. En partant du point de vue selon lequel le natif est celui qui connaît le mieux l’organisation de sa propre culture, et que la prise de recul qui lui est nécessaire pour pouvoir énoncer ses analyses et ses synthèses ne justifie en aucune manière que l’on théorise l’étrangeté de l’autre comme nécessité et prérequis du travail anthropologique. L’argument théorique le plus fort réside justement dans la conception de l’altérité : je ne peux pas connaître l’autre qui constitue le milieu d’interaction de « mon » autre, le natif, parce que l’autre de « mon » autre n’est pas nécessairement moi, mais tout autre. L’anthropologie qui en découle n’est pas exactement « symétrique », bien qu’elle se dénomme ainsi, mais elle est surtout perspectiviste.
Or, les expressions scientifiques, juridiques et culturelles utilisées dans les milieux de savoirs africains offrent certes un champ privilégié d’analyse de cette altérité culturelle avec des considérations épistémologiques héritées d’une anthropologie cognitive historiquement dépassée, mais qui aujourd’hui rythme la production mondiale des savoirs. C’est dans ce cadre qu’elles permettent de construire des identités, des mouvements créateurs de lien social et des constellations symboliques. Pour Camille Roger Abolou, les expressions qui en découlent recommandent des marchés aux structurations particulières qui défient sans cesse les procès de globalisation initié par l’Occident. En effet, l’offre de « l’expressivité » met en place des situations complexes comprenant des langues africaines (vernaculaires et véhiculaires) et des langues importées (français, anglais, etc.), supports respectifs des cultures locales et globales. Dès lors, la demande du « contenu », en tant qu‘impératif cognitif, esthétique et éthique, s’exprimant essentiellement par les signaux juridiques, scientifiques, culturels, plus ou moins moulés dans les processus de marchandisation, de glocalisation, d’ancestralisation, sape et manifeste autrement l’humain et les imaginaires y afférents.
Ce point de vue est corroboré par Joseph Tonda qui réinterprète le fonctionnement de l’imaginaire africain contemporain à la lumière de l’anthropologie. Pour lui, les sciences sociales africaines et africanistes sont en effet gênées par le trou noir que creuse le mouvement de cette vague. Elles s’épuisent en justificatifs de la banalité de ce qu’elles observent puisque, enseignent-elles, ce que l’on constate aujourd’hui en Afrique a également existé en Occident, ou dans les mondes asiatiques et travaillent à promouvoir l’optimisme d’une Afrique porteuse d’« une énergie formidable ». Elles dénoncent alors le racisme de l’« afropessimisme » et étalent à l’envie, quand elles le peuvent, les statistiques qui attestent que l’« Afrique va bien ». Le racisme inconscient qui commande de telles idées et la condescendance qu’elles expriment sont manifestes. Et pourtant, elles doivent bien se résoudre à affronter en toute conscience l’enroulement de la vie psychique des sociétés africaines dans la vague du néolibéralisme qui s’agrandit de la même « énergie formidable » des Africains, de leur inconstatable créativité en matière de littérature, de danse, de musique, de corps à l’intérieur du trou noir, pour inscrire la pensée dans une stratégie radicale de démythification des sociétés africaines.
Or, la dynamique de cette reprise peut se trouver contestée par un ébranlement lié au tournant actuel qui remet en cause les fondements et les fins, les notions de vérité, de faits, de sources ou d’archives au profit de la fiction. Liées à la transition postmoderne et à son assomption par l’historiographie indienne reprise par la pensée postcoloniale en Afrique, elles ont abouti à la grande place donnée à l’herméneutique qui porte un « linguistic turn », et qui détache le signifiant du signifié extralinguistique, critique l’universalisme à partir d’une propension au nominalisme, prône un retour à la sophistique et à l’idéalisme subjectif, en vue d’un constructivisme généralisé, légitime des savoirs hétérodoxes soi-disant alternatifs, etc., note Charles Romain Mbele.
Les échanges qui ont suivi ces premières communications ont permis d’argumenter les difficultés épistémologiques liées à l’appropriation des sciences humaines et sociales en Afrique et à leurs réinterprétations scientifiques dans les différents secteurs où celles-ci se sont impliquées dans les recherches en Afrique. Ces échanges ont montré à quel point les rapports sud/nord demeurent marqués par l’histoire. Le terrain épistémologique n’échappe pas à ce marquage et aux rapports de domination indus. Il impose néanmoins un schéma de tension visant sortir du « trou noir », dont les configurations épistémologiques en reste encore en cours de structuration.
Les communications proposées dans les panels ont montré que nombre de questions soulevées dans les exposés précédents, et observés dans les sciences sociales, portent les germes de leur improbable curabilité ontologique et épistémologique. Les sciences sociales africaines sont affectées par ce qu’Achille Mbembe rend par l’expression interminable incantation. Elles, selon lui, sont hantées par trois spectres : l’esclavage, la colonisation et l’apartheid. Est ainsi suggérée une réflexion sur les processus scientifiques comme principes méthodologiques de distanciation critique des sciences humaines et sociales avec elles-mêmes, dans leur vocation à interpréter les significations en circulations en Afrique. En critique africaine par exemple, cette examen se penche sur les axiologies, les valorisations conceptuelles et épistémologiques, pour voir si d’une part, les pratiques et usages méthodologiques proposés, et d’autre part, la construction et la diffusion de discours universitaires standardisés encadrant la production, la communication des savoirs et leurs démultiplications, y compris dans les universités africaines, rendent raison de l’Afrique réelle ou quotidienne, c’est-à-dire de ses traditions passées et présentes, des contextes de création romanesque différents qui en inspirent les significations, les projets et les buts divers poursuivis par des écrivains africains, au demeurant, différemment motivés par la conquête de l’espace littéraire francophone.
Si, à l’instar des personnages de différentes œuvres africaines, existe un socle permanent, construit autour des schèmes mentaux structurant les attitudes desdits personnages à partir des communautés dont ils sont issus (africains continentaux, afro-européens, afro-américains, latino-africains, etc.), on peut donc postuler le projet d’une critique qui, se donnant pour objet une archéologie de l’Afrique, s’exercerait sur les œuvres prises comme des sites de fouilles, de manière à proposer d’autres pistes d’analyse grâce auxquelles l’on pourrait remonter, à travers des traces identifiables, au passé ou, éventuellement, noter des altérations collectives ou individuelles. Cette idée d’une Anthropologie cognitive « africaine » entendue comme une tradition de pensée qui s’affranchisse de l’impérialisme conceptuel et méthodologique a été ainsi posée sur la base de l’importance et de la priorité rendues au terrain africain. Il revient donc aux chercheurs d’investir à nouveau des matériaux culturels tels que la langue et les systèmes de croyance via les méthodes d’abstraction disponibles, quitte à en inventer d’autres.
Or, cette aptitude n’est pas souvent une donnée évidente dans l’esprit des chercheurs africains. Et les communications de divers panels ont montré que les scientifiques du continent, en l’occurrence ceux de la nouvelle génération, épousent des formes de pensée et d’esthétique nourries par les contacts avec l’autre à cause du fait colonial. Ces formes esthétiques tantôt présentent une rupture vis-à-vis des normes héritées du Centre, tantôt posent de nouvelles problématiques de l’adaptation sur des espaces différents du terroir d’origine ou de la difficile construction de l’identité. Pour certains, cette ambiguïté et cette indétermination insinuent un doute épistémologique qui, en aucun cas, ne peut introduire à une pensée du « Post- » dans la pratique des sciences humaines et sociales dans l’Afrique contemporaine.
Il en est ainsi du phénomène postmoderne dans la littérature dont le crédo : « l’incrédulité à l’égard des métarécits » s’impose telle une révolution copernicienne dans la critique littéraire francophone d’Afrique subsaharienne, avec une hardiesse qui annihile une équation importante : le contexte avec ses variables historiques, socio-anthropologiques et philosophiques qui peut fragiliser sa pertinence et son efficacité opératoires lorsqu’il est appliqué au corpus africain. Or, ceci ne dénote que de l’illustration d’une « anthropologie littéraire » visible dont la « postmodernité » langagière et épistémologique est pratiquée et adulée par les Africains par transhumances conceptuelles et épistémologiques. Car depuis la vague des indépendances africaines survenues majoritairement au début des années 1960, de nombreux territoires ont sans cesse été renommés, réorganisés passant d’un « patronyme d’emprunt », correspondant au temps colonial, à une toponymie souvent tirée d’une langue locale ou faisant référence à une entité politique majeure dans l’Afrique précoloniale. Cette tendance qui relève généralement de la décision politique, sur un temps historique de plus en plus long, prend corps dans un monde postcolonial qui se redéfinit sans cesse, dans son rapport au « vieux continent » notamment, en objectivant son passé colonial dans une perspective de provincialisation de l’Occident notamment. Ce rapport avec le temps, l’espace et le symbolisme permet d’avoir des doutes quant au basculement temporel et culturel dont la postmodernité est la figure. Il conduit à entrevoir la nécessité d’ouvrir et d’explorer d’autres voies de questionnement en vue d’un examen plus rationnel des concepts et des méthodologies à la mode sur le terrain africain.
C’est sans doute sur le plan politologue que s’affirme cette nécessité. D’où la critique de l’expression du politique au niveau panafricain, notamment l’« agenda 2063 » qui se fonde sur la Déclaration solennelle du 50me anniversaire et sur les « aspirations africaines ». Si l’ambition est noble, elle soulève cependant un nombre d’interrogations qui concernent les outils, les concepts qui sont proposés et les stratégies qui doivent être mises en œuvre afin que l’Afrique atteigne un stade supérieur de son évolution. Le contenu de ce document renseigne aussi sur les repères et les références des auteurs, notamment ceux qui portent et mettent en œuvre le projet africain. Il aide à comprendre, en partie au moins les contradictions sinon les faiblesses inhérentes à l’expression pertinente du politique au niveau continental. Or, les stratégies suggérées dans cet Agenda dévoilent un écart entre le diagnostic qui peut être posé et les solutions retenues. De fait, une sorte d’anthropologie politique du « Post- » permet d’appréhender et de s’interroger sur la perception des rapports sud/nord de l’aide au développement qui est devenue une composante importante des politiques publiques en Afrique subsaharienne, surtout en cette période des recompositions territoriales. Si cette aide souffre toujours d’être cantonnée dans une logique technocratique contradictoire avec sa nature inévitablement politique, il convient donc de lui donner son sens politique qui replace la quête légitime d’intérêts nationaux et locaux dans le cadre d’un projet collectif lié à la bonne gouvernance nationale et locale.
Au reste, cette analyse s’appuie sur l’observation en Afrique de l’héritage coloniale du traitement public de l’espace ancestral, lequel passe pour en être une des métaphores parmi les plus expressives de l’anthropologie des rapports sud/nord. En effet, depuis l’époque coloniale, jusqu’à la période actuelle en passant par la période postcoloniale, la tendance générale est au remplacement progressif du couvert végétal par des surfaces imperméabilisées. Pour les villes africaines en général et les villes gabonaises en particulier, on ignore les « forces » qui gouvernent les modifications de l’occupation du sol. Or, pour parvenir à maîtriser cette occupation, le scientifique doit s’appuyer sur l’anthropologie. Au-delà donc d’une épistémologie des sciences humaines et de l’anthropologie spécifiquement parlant, on gagnera à étendre la réception du sens des sciences en Afrique à travers une approche critique du postcolonialisme/post-colonialisme à travers ce qu’il est possible d’appeler : une « pratique anthropologique » du visible. Car du côté des peuples, les réalités de l’Afrique contemporaine prise dans le tourbillon du néolibéralisme et du tout-monde posent « le problème du présent marqué par la forte volonté de vivre ailleurs que chez soi exprimée au moyen des prières d’espérance à connotation prophétique, par la projection onirique sur l’espace euro-américain en surfant sur les sites Internet et dans l’espace onirique, ou par l’engagement sur les chemins périlleux de l’émigration, bref, cet accent vise à faire prendre la mesure de ce que le présent représente sur les plans de l’inconscient anthropologique et sociologique : que dit cet inconscient du social sur ce qui influe sur la vie réelle des groupes, des classes ou des masses de nos jours ? Comment cet inconscient, dont les familles, les parentèles, les quartiers, les rues, les résidences des quartiers urbains, les villages, les terres d’immigration, sont les lieux de territorialisation, se présente-t-il par rapport aux politiques et aux imaginaires du néolibéralisme, de leurs lieux de fixation ou de matérialisation, de leurs agents et institutions d’application ? Nous pensons que c’est à ce niveau qu’il importe d’orienter la recherche sur le rapport des Africains au futur », a rappelé Joseph Tonda.
In fine, à travers cette voix/voie, mais aussi de nombreuses autres réunies à Libreville les 14 et 15 juin 2018, et à travers leurs échos, évocations et révocations, le colloque « Les post- et les anthropologies en Afrique » a définitivement mis en relief la diversité de la réception critique du concept de « Post » rattaché aux discours et aux herméneutiques en vogue dans les écrits contemporains sur l’Afrique. Mais les usages de ce concept ne peuvent faire l’économie d’un questionnement plus élargi que celui de Libreville. L’espace-temps de ce forum, bien qu’ouvert et diversifié sur le plan des outils conceptuels et des méthodes, n’a pu en effet conduire à en faire le tour et le détour, les passions et les débats reportant sans cesse l’examen plus en profondeur des problématiques abordées.
Au total, ce que l’on retiendra de nos interrogations individuelles et communes, c’est moins, comme l’a si bien rappelé Charles Romain Mbele, le besoin d’imiter et d’amplifier les modes intellectuelles que celui de questionner radicalement les méthodologies, les épistémologies, les gnoséologies qui viennent à nous, que nous produisons, mais en fonction d’abord et surtout de la « dialectique de nos besoins », pour reprendre une exigence césairienne. Ceci implique que les sciences sociales doivent toujours poursuivre l’objectif de rendre intelligible notre rapport au passé, au présent et à l’avenir, de chercher la vérité - loin des impasses méthodologiques - qui refusent de prendre en compte la provenance historique, la rationalité du social et une direction donnée aux significations et aux trajectoires.
La sémiotique perspectiviste qui conteste les modèles de pensée dominants en recherchant les méthodologies du divers situe parfaitement l’enjeu de cette tension et ses significations.
La Rapporteure Générale
Noëlline Sallah
++Rapport Général du Colloque « Les post- et les anthropologies en Afrique ».Le colloque national « Les post- et les anthropologies en Afrique », organisé par les Editions Oudjat en Ligne à l’Université Omar Bongo les 14 et 15 juin 2018, avec les soutiens institutionnels de l’Université Omar Bongo, de l’Institut de Recherche en Sciences Humaines et de l’Agence Universitaire de la Francophonie, a enregistré plus d’une vingtaine de communications présentées, pour certaines, sous forme de conférence inaugurale et de conférences plénières, et pour d’autres, sous formes de communications intégrées à quatre panels thématiques. Ceux-ci se présentaient comme suit : Panel 1 : Epistémologies et empirismes critiques ; Quatre conférences dont la conférence inaugurale de Jacques Fontanille (Université de Limoges), les plénières de Camille Roger Abolou (Université de Bouaké), Joseph Tonda (Université Omar Bongo), et de Charles Romain Mbele (Ecole Normale Supérieure de l’Université de Yaoundé 1), ont permis de démêler les difficultés épistémologiques et les problématiques méthodologiques auxquelles sont confrontées les sciences sociales en Afrique subsaharienne. Au cours des différentes conférences, un accent particulier a été porté sur l’anthropologie telle que pratiquée et enseignée dans les universités africaines. En effet, l’anthropologie contemporaine est prise dans un mouvement de réexamen des conséquences théoriques et épistémologiques des colonialismes, ainsi que dans une remise en question et une relativisation des présupposés du naturalisme moderne, qui radicalement a transformé le rapport à l’autre. Les avancées de l’éthologie sémiotique, entre autres domaines de recherche, conduisent à ces interrogations. Or, les expressions scientifiques, juridiques et culturelles utilisées dans les milieux de savoirs africains offrent certes un champ privilégié d’analyse de cette altérité culturelle avec des considérations épistémologiques héritées d’une anthropologie cognitive historiquement dépassée, mais qui aujourd’hui rythme la production mondiale des savoirs. C’est dans ce cadre qu’elles permettent de construire des identités, des mouvements créateurs de lien social et des constellations symboliques. Pour Camille Roger Abolou, les expressions qui en découlent recommandent des marchés aux structurations particulières qui défient sans cesse les procès de globalisation initié par l’Occident. En effet, l’offre de « l’expressivité » met en place des situations complexes comprenant des langues africaines (vernaculaires et véhiculaires) et des langues importées (français, anglais, etc.), supports respectifs des cultures locales et globales. Dès lors, la demande du « contenu », en tant qu‘impératif cognitif, esthétique et éthique, s’exprimant essentiellement par les signaux juridiques, scientifiques, culturels, plus ou moins moulés dans les processus de marchandisation, de glocalisation, d’ancestralisation, sape et manifeste autrement l’humain et les imaginaires y afférents. Ce point de vue est corroboré par Joseph Tonda qui réinterprète le fonctionnement de l’imaginaire africain contemporain à la lumière de l’anthropologie. Pour lui, les sciences sociales africaines et africanistes sont en effet gênées par le trou noir que creuse le mouvement de cette vague. Elles s’épuisent en justificatifs de la banalité de ce qu’elles observent puisque, enseignent-elles, ce que l’on constate aujourd’hui en Afrique a également existé en Occident, ou dans les mondes asiatiques et travaillent à promouvoir l’optimisme d’une Afrique porteuse d’« une énergie formidable ». Elles dénoncent alors le racisme de l’« afropessimisme » et étalent à l’envie, quand elles le peuvent, les statistiques qui attestent que l’« Afrique va bien ». Le racisme inconscient qui commande de telles idées et la condescendance qu’elles expriment sont manifestes. Et pourtant, elles doivent bien se résoudre à affronter en toute conscience l’enroulement de la vie psychique des sociétés africaines dans la vague du néolibéralisme qui s’agrandit de la même « énergie formidable » des Africains, de leur inconstatable créativité en matière de littérature, de danse, de musique, de corps à l’intérieur du trou noir, pour inscrire la pensée dans une stratégie radicale de démythification des sociétés africaines. Or, la dynamique de cette reprise peut se trouver contestée par un ébranlement lié au tournant actuel qui remet en cause les fondements et les fins, les notions de vérité, de faits, de sources ou d’archives au profit de la fiction. Liées à la transition postmoderne et à son assomption par l’historiographie indienne reprise par la pensée postcoloniale en Afrique, elles ont abouti à la grande place donnée à l’herméneutique qui porte un « linguistic turn », et qui détache le signifiant du signifié extralinguistique, critique l’universalisme à partir d’une propension au nominalisme, prône un retour à la sophistique et à l’idéalisme subjectif, en vue d’un constructivisme généralisé, légitime des savoirs hétérodoxes soi-disant alternatifs, etc., note Charles Romain Mbele. Les échanges qui ont suivi ces premières communications ont permis d’argumenter les difficultés épistémologiques liées à l’appropriation des sciences humaines et sociales en Afrique et à leurs réinterprétations scientifiques dans les différents secteurs où celles-ci se sont impliquées dans les recherches en Afrique. Ces échanges ont montré à quel point les rapports sud/nord demeurent marqués par l’histoire. Le terrain épistémologique n’échappe pas à ce marquage et aux rapports de domination indus. Il impose néanmoins un schéma de tension visant sortir du « trou noir », dont les configurations épistémologiques en reste encore en cours de structuration. Les communications proposées dans les panels ont montré que nombre de questions soulevées dans les exposés précédents, et observés dans les sciences sociales, portent les germes de leur improbable curabilité ontologique et épistémologique. Les sciences sociales africaines sont affectées par ce qu’Achille Mbembe rend par l’expression interminable incantation. Elles, selon lui, sont hantées par trois spectres : l’esclavage, la colonisation et l’apartheid. Est ainsi suggérée une réflexion sur les processus scientifiques comme principes méthodologiques de distanciation critique des sciences humaines et sociales avec elles-mêmes, dans leur vocation à interpréter les significations en circulations en Afrique. En critique africaine par exemple, cette examen se penche sur les axiologies, les valorisations conceptuelles et épistémologiques, pour voir si d’une part, les pratiques et usages méthodologiques proposés, et d’autre part, la construction et la diffusion de discours universitaires standardisés encadrant la production, la communication des savoirs et leurs démultiplications, y compris dans les universités africaines, rendent raison de l’Afrique réelle ou quotidienne, c’est-à-dire de ses traditions passées et présentes, des contextes de création romanesque différents qui en inspirent les significations, les projets et les buts divers poursuivis par des écrivains africains, au demeurant, différemment motivés par la conquête de l’espace littéraire francophone. Si, à l’instar des personnages de différentes œuvres africaines, existe un socle permanent, construit autour des schèmes mentaux structurant les attitudes desdits personnages à partir des communautés dont ils sont issus (africains continentaux, afro-européens, afro-américains, latino-africains, etc.), on peut donc postuler le projet d’une critique qui, se donnant pour objet une archéologie de l’Afrique, s’exercerait sur les œuvres prises comme des sites de fouilles, de manière à proposer d’autres pistes d’analyse grâce auxquelles l’on pourrait remonter, à travers des traces identifiables, au passé ou, éventuellement, noter des altérations collectives ou individuelles. Cette idée d’une Anthropologie cognitive « africaine » entendue comme une tradition de pensée qui s’affranchisse de l’impérialisme conceptuel et méthodologique a été ainsi posée sur la base de l’importance et de la priorité rendues au terrain africain. Il revient donc aux chercheurs d’investir à nouveau des matériaux culturels tels que la langue et les systèmes de croyance via les méthodes d’abstraction disponibles, quitte à en inventer d’autres. Or, cette aptitude n’est pas souvent une donnée évidente dans l’esprit des chercheurs africains. Et les communications de divers panels ont montré que les scientifiques du continent, en l’occurrence ceux de la nouvelle génération, épousent des formes de pensée et d’esthétique nourries par les contacts avec l’autre à cause du fait colonial. Ces formes esthétiques tantôt présentent une rupture vis-à-vis des normes héritées du Centre, tantôt posent de nouvelles problématiques de l’adaptation sur des espaces différents du terroir d’origine ou de la difficile construction de l’identité. Pour certains, cette ambiguïté et cette indétermination insinuent un doute épistémologique qui, en aucun cas, ne peut introduire à une pensée du « Post- » dans la pratique des sciences humaines et sociales dans l’Afrique contemporaine. Il en est ainsi du phénomène postmoderne dans la littérature dont le crédo : « l’incrédulité à l’égard des métarécits » s’impose telle une révolution copernicienne dans la critique littéraire francophone d’Afrique subsaharienne, avec une hardiesse qui annihile une équation importante : le contexte avec ses variables historiques, socio-anthropologiques et philosophiques qui peut fragiliser sa pertinence et son efficacité opératoires lorsqu’il est appliqué au corpus africain. Or, ceci ne dénote que de l’illustration d’une « anthropologie littéraire » visible dont la « postmodernité » langagière et épistémologique est pratiquée et adulée par les Africains par transhumances conceptuelles et épistémologiques. Car depuis la vague des indépendances africaines survenues majoritairement au début des années 1960, de nombreux territoires ont sans cesse été renommés, réorganisés passant d’un « patronyme d’emprunt », correspondant au temps colonial, à une toponymie souvent tirée d’une langue locale ou faisant référence à une entité politique majeure dans l’Afrique précoloniale. Cette tendance qui relève généralement de la décision politique, sur un temps historique de plus en plus long, prend corps dans un monde postcolonial qui se redéfinit sans cesse, dans son rapport au « vieux continent » notamment, en objectivant son passé colonial dans une perspective de provincialisation de l’Occident notamment. Ce rapport avec le temps, l’espace et le symbolisme permet d’avoir des doutes quant au basculement temporel et culturel dont la postmodernité est la figure. Il conduit à entrevoir la nécessité d’ouvrir et d’explorer d’autres voies de questionnement en vue d’un examen plus rationnel des concepts et des méthodologies à la mode sur le terrain africain. C’est sans doute sur le plan politologue que s’affirme cette nécessité. D’où la critique de l’expression du politique au niveau panafricain, notamment l’« agenda 2063 » qui se fonde sur la Déclaration solennelle du 50me anniversaire et sur les « aspirations africaines ». Si l’ambition est noble, elle soulève cependant un nombre d’interrogations qui concernent les outils, les concepts qui sont proposés et les stratégies qui doivent être mises en œuvre afin que l’Afrique atteigne un stade supérieur de son évolution. Le contenu de ce document renseigne aussi sur les repères et les références des auteurs, notamment ceux qui portent et mettent en œuvre le projet africain. Il aide à comprendre, en partie au moins les contradictions sinon les faiblesses inhérentes à l’expression pertinente du politique au niveau continental. Or, les stratégies suggérées dans cet Agenda dévoilent un écart entre le diagnostic qui peut être posé et les solutions retenues. De fait, une sorte d’anthropologie politique du « Post- » permet d’appréhender et de s’interroger sur la perception des rapports sud/nord de l’aide au développement qui est devenue une composante importante des politiques publiques en Afrique subsaharienne, surtout en cette période des recompositions territoriales. Si cette aide souffre toujours d’être cantonnée dans une logique technocratique contradictoire avec sa nature inévitablement politique, il convient donc de lui donner son sens politique qui replace la quête légitime d’intérêts nationaux et locaux dans le cadre d’un projet collectif lié à la bonne gouvernance nationale et locale. Au reste, cette analyse s’appuie sur l’observation en Afrique de l’héritage coloniale du traitement public de l’espace ancestral, lequel passe pour en être une des métaphores parmi les plus expressives de l’anthropologie des rapports sud/nord. En effet, depuis l’époque coloniale, jusqu’à la période actuelle en passant par la période postcoloniale, la tendance générale est au remplacement progressif du couvert végétal par des surfaces imperméabilisées. Pour les villes africaines en général et les villes gabonaises en particulier, on ignore les « forces » qui gouvernent les modifications de l’occupation du sol. Or, pour parvenir à maîtriser cette occupation, le scientifique doit s’appuyer sur l’anthropologie. Au-delà donc d’une épistémologie des sciences humaines et de l’anthropologie spécifiquement parlant, on gagnera à étendre la réception du sens des sciences en Afrique à travers une approche critique du postcolonialisme/post-colonialisme à travers ce qu’il est possible d’appeler : une « pratique anthropologique » du visible. Car du côté des peuples, les réalités de l’Afrique contemporaine prise dans le tourbillon du néolibéralisme et du tout-monde posent « le problème du présent marqué par la forte volonté de vivre ailleurs que chez soi exprimée au moyen des prières d’espérance à connotation prophétique, par la projection onirique sur l’espace euro-américain en surfant sur les sites Internet et dans l’espace onirique, ou par l’engagement sur les chemins périlleux de l’émigration, bref, cet accent vise à faire prendre la mesure de ce que le présent représente sur les plans de l’inconscient anthropologique et sociologique : que dit cet inconscient du social sur ce qui influe sur la vie réelle des groupes, des classes ou des masses de nos jours ? Comment cet inconscient, dont les familles, les parentèles, les quartiers, les rues, les résidences des quartiers urbains, les villages, les terres d’immigration, sont les lieux de territorialisation, se présente-t-il par rapport aux politiques et aux imaginaires du néolibéralisme, de leurs lieux de fixation ou de matérialisation, de leurs agents et institutions d’application ? Nous pensons que c’est à ce niveau qu’il importe d’orienter la recherche sur le rapport des Africains au futur », a rappelé Joseph Tonda. In fine, à travers cette voix/voie, mais aussi de nombreuses autres réunies à Libreville les 14 et 15 juin 2018, et à travers leurs échos, évocations et révocations, le colloque « Les post- et les anthropologies en Afrique » a définitivement mis en relief la diversité de la réception critique du concept de « Post » rattaché aux discours et aux herméneutiques en vogue dans les écrits contemporains sur l’Afrique. Mais les usages de ce concept ne peuvent faire l’économie d’un questionnement plus élargi que celui de Libreville. L’espace-temps de ce forum, bien qu’ouvert et diversifié sur le plan des outils conceptuels et des méthodes, n’a pu en effet conduire à en faire le tour et le détour, les passions et les débats reportant sans cesse l’examen plus en profondeur des problématiques abordées. Au total, ce que l’on retiendra de nos interrogations individuelles et communes, c’est moins, comme l’a si bien rappelé Charles Romain Mbele, le besoin d’imiter et d’amplifier les modes intellectuelles que celui de questionner radicalement les méthodologies, les épistémologies, les gnoséologies qui viennent à nous, que nous produisons, mais en fonction d’abord et surtout de la « dialectique de nos besoins », pour reprendre une exigence césairienne. Ceci implique que les sciences sociales doivent toujours poursuivre l’objectif de rendre intelligible notre rapport au passé, au présent et à l’avenir, de chercher la vérité - loin des impasses méthodologiques - qui refusent de prendre en compte la provenance historique, la rationalité du social et une direction donnée aux significations et aux trajectoires. La sémiotique perspectiviste qui conteste les modèles de pensée dominants en recherchant les méthodologies du divers situe parfaitement l’enjeu de cette tension et ses significations.
Noëlline Sallah |

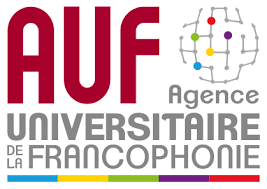
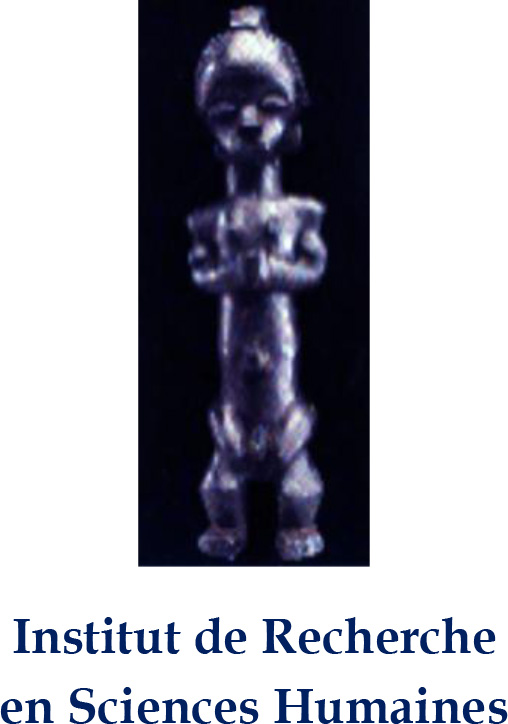 la penser ensemble...
la penser ensemble...